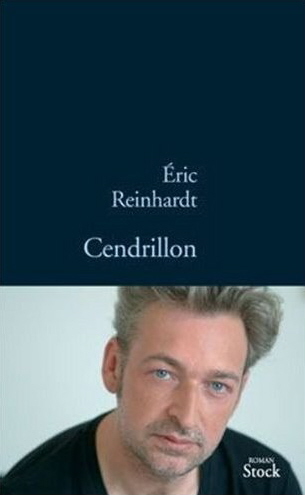[Attention spoilers] Malgré ses nombreuses qualités, « Existence », le précédent roman d’Eric Reinhardt, ne laissait en rien présager du monstre littéraire qui allait lui succéder. Cynique, féroce et parfaitement construit, il confirmait après le « Moral des ménages » le talent de l’écrivain pour réaliser des satires sociales désenchantées, mais maintenait l’homme dans le sillage de la littérature contemporaine française. Au niveau du style et du récit, aucun éclair de génie ne permettait de deviner qu’Eric Reinhardt avait les épaules assez larges pour devenir calife à la place du calife, pour mener seul une guerre qu’on pensait que personne n’oserait jamais déclencher.
« Cendrillon » est un pavé (au sens propre comme au sens figuré) jeté à la gueule fardée de l’establishment littéraire français. Aux autofictions complaisantes et faussement provocatrices, aux introspections psychanalytiques de bas étages, aux histoires vaines qui voudraient avoir un impact politique, aux romans de 150 pages écrits en « Times New Roman / font-size : 16 px », aux niaiseries académiques pompeuses, aux phrases simplistes couchées sur le papier en mai pour une publication au début de l’été, à tout ce que nous a habitué la littérature française contemporaine, Eric Reinhardt répond par une odyssée qui absorbe comme un tourbillon autant de pans de l’approche littéraire que possible.
Pour mieux prendre à revers le lecteur et la « critique littéraire », « Cendrillon » emprunte des sillons trompeurs. Le monstre se focalise d’abord sur trois personnages : Laurent Dahl, Thierry Trockel et Patrick Neftel. Se jouant de la temporalité et remontant loin dans les origines de chacun de ses protagonistes, Eric Reinhardt semble en premier lieu s’aventurer sur les terres de ceux qui conçoivent leurs œuvres comme des épopées où les destins des personnages ne prendront sens qu’une fois replacés dans un contexte global formant une aventure humaine épique. On pense ainsi à ces anglo-saxons, Jonathan Coe en tête, qui n’ont pas peur de noircir des pages et des pages avant de dévoiler les interactions auxquelles seront soumis leurs protagonistes. Puis très vite, « Cendrillon » revêt des aspirations autobiographiques, mais pas de celles qui ennuient leurs lecteurs avec leurs récurrentes thématiques de l’écrivain complexe, obsédé mais torturé, lâche mais touchant, non Eric Reinhardt se présente sous un angle tellement « différent » qu’aucune comparaison ne me vient à l’esprit. Brouillant les pistes, alternant entre une émouvante transparence et entre une mise en scène fictionnelle de son propre moi, il ne tarde pas à révéler que tous ses héros ne sont que des alter-égo de lui-même, des doubles littéraires qui lui ressemblent sans lui ressembler, ouvrant ainsi, avec une crédibilité inédite les arcanes de la création littéraire.
Rares sont les thèmes de la vie qui sont laissés de côté : amour, cellule familiale, paternité, carcan social, politique… aucun domaine ne semble mettre Eric Reinhardt mal à l’aise. Même quand ce dernier s’attaque à des notions économiques, sujet sur lequel se ridiculise la majorité des hommes lettrés, il impressionne, un peu à la manière d’un Houellebecq, par sa capacité à disserter sans que cela ne donne l’impression de sortir du texte. Lors du dialogue théorique avec Louis Schweitzer ou au cours des aventures financières de Laurent Dahl, il expose sa vision d’un capitalisme corrompu par l’actionnariat, vulgarise la problématique des fonds de pension, sans pour autant jamais nier la logique économique (chose que mêmes certains de nos politiciens ne sont pas toujours capables de faire). Ainsi, il développe, sous ses airs de ne pas y toucher, et ce au sein d’un grand roman, un véritable point de vue entre résignation et envie de révolution ; la peur y étant exposée comme le seul contre-pouvoir capable de redresser, via la notion de compromis, le capitalisme et donc le fonctionnement de notre monde.
Des phrases, que dis-je des paragraphes, que je souhaiterais vous recopier tels quels, il y en a ici des centaines : l’épiphanie, l’automne, les mots mallarméens, la passion, les obsessions, les schémas de pensées, la complicité analogique avec la vitesse et l’obliquité des nuages… tout ici est occasion à des divergences poétiques, à des envolés lyriques qui prennent aux trippes. Rarement, je me suis senti autant en phase avec la vision de l’art et de l’amour d’un auteur ; et ce sentiment qu’on ne réserve habituellement qu’aux plus grands (Proust, Balzac…) révèle bien la puissance de cette folie des grandeurs menée à son terme avec brio.
Vers la fin, la mise en abîme est peut être trop flagrante, et la charge contre la bourgeoisie intellectuelle de gauche un peu trop directe (quoique des plus savoureuses), mais peu importe tant « Cendrillon » n’est pas qu’un combat mais un véritable cri de ralliement. Peu importe les défauts, Eric Reinhardt a gagné : il a attaqué tous les auteurs en vue sur leur propre terrain et les a écrasé aussi bien au sprint que sur la distance.
Une « critique » me parait bien peu de chose par rapport à ce roman qui mériterait à minima une analyse de texte. Ainsi je préfère m’arrêter là et finir sur ces mots de l’auteur : « L’amour pas plus que le chef d’œuvre ne tombe du ciel sans effort. […] Vous êtes des paresseux, Vous manquez d’ambition. Vous adorez céder à des inclinations communes. » Se sente visé, qui de droit !
Note : 9/10