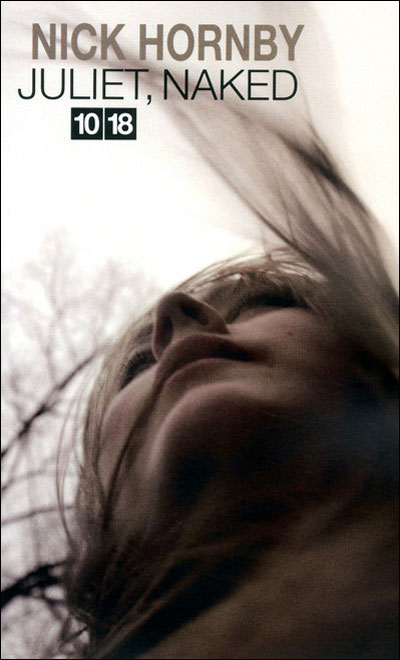Nick Hornby a toujours été cet ami avec qui vous partagez la passion mais rarement les points de vue. Depuis son générationnel « High Fidelity » et sa cultissime adaptation cinématographique par Stephen Frears (l’un comme l’autre ne s’en remettront jamais vraiment), il est l’incarnation de ce genre d’auteur qui ne génère pas l’affection par les mots mais par la connivence culturelle et l’identification. Du coup le fond disparait au profit de la joie simple et humaine de se retrouver dans des personnages de fiction, chaque passionné de musique pouvant être vu comme une composition réalisée selon des dosages différents à partir des profils des trois protagonistes de ce second roman. Pourtant, et malgré les souvenirs que vous partagez avec lui, malgré toutes ces soirées de franches rigolades, malgré tous ces fameux tops réalisées dans l’ivresse des sorties musicales, vous ne pouvez pas vous empêcher de le trouver parfois un brin fatiguant et trop confiant dans son propre personnage.
C’est peut-être justement parce qu’il est facile de se sentir proche de lui, que les reproches viennent de plus en plus facilement aux lèvres. En 2003, il publie « 31 songs » un recueil de courts textes chacun liés à une chanson, le tout en forme de bande-son de sa vie. Le résultat est tellement médiocre qu’il en dévalue l’intégralité de son œuvre obligeant même le lecteur à réinspecter le passé sous une lumière nouvelle et à y discerner des tâches anciennement passées inaperçues. La vérité (et c’est sans doute de là que découle la frustration et donc l’énervement) est que « 31 songs » est le bouquin que n’importe quel passionné de musique voudrait (et aurait surement les capacités de) écrire et que l’écrivain n’a rien fait de l’opportunité que son succès avait crée. Outre le fait qu’il mette en exergue des chansons qui auraient tendance à nier sa qualité de spécialiste (sans juger des goûts, je ne suis pas persuadé qu’il soit objectivement pertinent de sélectionner « I’m like a bird » de Nelly Furtado dans un top si restreint) et qu’il essaye sans succès de traiter avec humour et ironie des clichés du rock (« L’interprétation traditionnelle de l’engouement des garçons pour le heavy metal – ou le nu metal ou le rap – inclut des guitares qui servent de substitut du pénis, de l’homo-erotisme, et toutes sortes d’autres choses qui sont l’indice d’une perversité, d’une confusion sexuelle, d’inextricables névroses morbides. » ; soit), le recueil dévoile surtout un nombrilisme et une certaine auto-complaisance (qu’il dénonce chez les autres d’ailleurs). Ainsi, il détaille longuement, et avec une fierté mal placée, comment il jette à la poubelle sur seule foi d’une pochette ou d’un communiqué de presse qui fait référence à l’un des 300 000 artistes qu’il ne juge pas digne d’intérêt, les CD qu’il reçoit dans le cadre de son activité de critique au sein du New Yorker. Pour un peu, il nous expliquerait comment chroniquer un disque (sic). Il se permet même de se prendre pour un troll bloguistique en écrivant avec aplomb que tous ceux qui n’aiment pas la musique pop d’aujourd’hui, sont des imposteurs dont les goûts sont conditionnés par leur intellectualisme (référence à Harold Bloom) et qu’il s’agit de gens qui ne savent pas s’amuser et faire la fête ; soit le genre de discours qu’on peut régulièrement lire dans les commentaires de n’importe quelle critique négative de n’importe quel album mainstream…
Si j’aborde le point du blog, c’est parce que forcément on en revient à la frustration. Frustration futile mais frustration tout de même de réaliser que « le plus grand auteur pop du monde » est incapable d’écrire un article à la hauteur de ce que fait chaque jour KMS, avec plus de style et de passion (si un éditeur passe dans le coin…). Il ne s’agit nullement de s’offusquer d’un manque de reconnaissance ou d’ergoter sur le niveau d’intransigeance que doit avoir un artiste (qui écrit dans le cadre d’une œuvre globale) face à un blogueur (qui écrit dans la passion de l’instant), tant le débat serait vain, prétentieux et plein d’une gênante aigreur, mais plus de bien souligner que Nick Hornby n’est pas LA référence universelle en matière de rock’n’roll (les références n’ayant de toute façon jamais lieu d’être ici).
Cette longue divagation sur « 31 songs » semble nécessaire tant on y retrouve certaines des anecdotes qui auront conduit à « Juliet, Naked ». Sans parler du jeu Jackson Browne / Jackson Crowe, le livre évoque déjà le parcours de Tucker Crowe sur le passage Ani DiFranco / Aimee Mann : « Rien de plus rasoir, pourrait-on penser, que ces chansons en miroir qui évoquent la vie dans l’univers de la musique – les joies et les souffrances d’un auteur-compositeur – interprète talentueux mais qui galère (I’ve Had It), la difficulté de mener de front une relation sentimentale et une carrière dans le rock’n’roll (You Had Time) », ainsi que le personnage de Duncan via cet ami qui est connecté 24h/24 au forum de Expecting Rain et qui possède plus de 130 disques de Bob Dylan. Heureusement, cadre du roman oblige, Nick Hornby met de côté ses analyses musicales condescendantes, pour se focaliser sur les personnages, et du coup ce qui n’était que simples anecdotes se transforment ici en une histoire cohérente qui évolue sous l’égide d’une question centrale : « Que fait-on lorsqu’on pense qu’on a gâché quinze ans de sa vie ? » ; « gaché » signifiant ici soit « ne pas avoir fait de musique », soit « s’être vainement consacré à son analyse ». Un positionnement binaire qui pousse forcément des gens comme moi à la réflexion.
Mais là où la connivence permettait à « High Fidelity » de fonctionner parfaitement, « Juliet, Naked » souffre du temps qui passe et de la difficulté à rester en phase avec la nouvelle génération. Ce n’est pas pour rien si les héros ont entre quarante et cinquante ans, ils incarnent ces adultes qui restent d’éternels adolescents, mais des adolescents prisonniers de leur propre époque. Nick Hornby semble ainsi bien mal à l’aise avec tout ce qui touche à la modernité musicale et à notre manière de la consommer : Duncan arpente un unique forum (on aurait justement préféré qu’il tienne un blog), les faux articles sur Wikipedia sonnent faux, le mot de l’attaché de presse (« Et j’ai pensé que vous devriez être l’un des premiers à l’écouter ») relève de l’utopie – à moins qu’il n’ait été envoyé par Damien Capitan – et si l’on apprécie la tentative de vivre avec son temps de l’auteur, on a un peu du mal à croire que la première chose qu’un crowologue fait lorsqu’il reçoit le nouveau disque de l’être admiré, c’est de le convertir en MP3 pour l’écouter sur son Ipod. Même les pseudos des membres du forum semblent avoir été trouvés sous la torture (Julietlover, MrMozza7…).
Cependant en faisant fi de ces quelques détails de forme, « Juliet, Naked » s’avère fluide et agréable. Cette histoire d’un couple dont la vie a été corrélée, jusque dans sa rupture, à celle d’un artiste qui a disparu est engageante. Le fait que la séparation soit symboliquement le moment que choisi Tucker pour réapparaitre et se substituer au passionné, sans pour autant être un parti plus valide, permet
de créer un charmant triangle amoureux romanesque. D’autant plus qu’il y a une vraie imagerie naïvement touchante dans le flirt entre fan et artiste déclenché suite à la publication d’une critique (Joanna, si tu m’entends…).
La manière dont le roman montre combien les schémas de reconnaissance ont été modifiés est assez pertinente. Dans « Juliet, Naked », tout le monde est à la fois connu et inconnu selon le référentiel dans lequel il évolue. Il en va de Tucker Crowe et de Duncan bien sûr mais aussi des danseurs de Northern Soul et de Julie Beatty, une femme qui en donnant son nom à un album est devenue un emblème mystérieux. De même, il y a une vraie destruction des schémas sur ce que doit accomplir l’homme pour devenir « un homme sérieux ».
Au final, ni l’artiste ni le critique ne sont heureux, le premier vit dans l’imposture musicale, de par l’exagération de la réalité dans le texte de ses chansons, tandis que le second vit dans le mensonge prônant l’existence dans les titres d’un niveau de lecture qui n’existe pas (cf ma rencontre avec Katerine).
On regrette qu’il n’y ait pas une plus grande force dans le schéma narratif (Jonathan Coe aurait fait des merveilles avec la même idée) et que la majorité des scènes clefs comme la rencontre Duncan / Tucker Crowe soit particulièrement ratée, le discours du premier au second manquant cruellement de la magie rhétorique permettant le revirement psychologique. Il faut dire aussi que celui qui déclare « styliste que je suis en matière de prose » reste bien avare en matière de fulgurances littéraires.
C’est à la fois sa force et sa faiblesse mais Nick Hornby est un auteur à thèmes spécifiques. Musique, foot et paternité (ou plus globalement l’éducation) sont dans des proportions différentes chaque fois au cœur de ses romans. Le problème c’est que l’anglais se retrouve aujourd’hui dans une impasse : d’une part, il commence à avoir fait le tour de ses sujets de prédilection et des gimmicks hornbiens, de l’autre, il n’a pas forcément les ressources littéraires nécessaires pour s’imposer sur des terres complètement vierges. « Juliet, Naked » est réussi dans le sens où il tire partie de toutes les qualités de son auteur. Néanmoins, on a vraiment l’impression que ce dernier épuise ici ses dernières cartouches et que jamais plus il ne pourra plus continuer à vivre sur ses acquis.
Note : 6,5/10