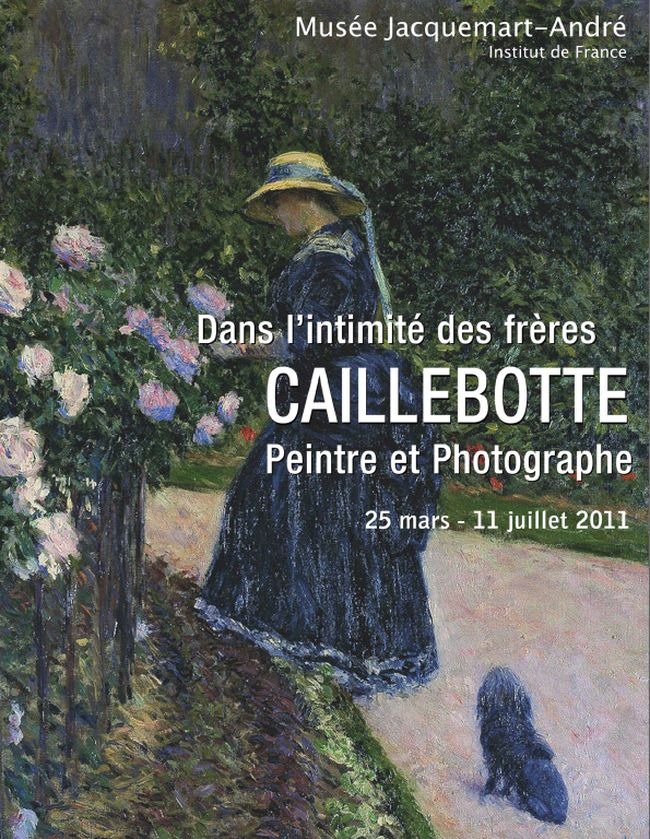Pour l’une de ces rares expositions qui l’emmènent au-delà du XVIIIème, le musée Jacquemart-André a justement choisi de conter l’histoire de deux artistes qui ont focalisé leur œuvre sur la mutation de Paris et sa banlieue dans la deuxième moitié du XIXème. L’exposition débute donc sur un Paris en pleine transformation où apparaissent machineries et nouveaux métiers et où les hommes se protègent de la circulation grâce à des refuges, et chez les deux frères (et ceux malgré les années d’écart ; Martial Caillebotte ne se mettant à la photographie que 3 ans avant le décès de Gustave), on sent cette même nécessité d’observer frontalement mais en cadrant différemment ou en jouant des perspectives. Mais cette manière de voir la ville toujours d’un balcon ou d’un point d’observation n’implique pas une volonté de se mettre en dehors. Au contraire on sent toujours un grand respect et une grande bienveillance à l’égard de leurs sujets ; des toiles et des photos qui peuvent être pesantes ou éblouissantes, mais qui ne tombent jamais dans aucun cynisme.
Sous le prétexte d’honorer les cent ans de la mort de Martial Caillebotte, le Jacquemart-André a donc eu la grande idée de remettre en perspective la peinture de Gustave à l’aune des photos de son frère. On pourrait justement n’y voir que prétexte et trouver l’occasion facile, on pourrait dénigrer la transformation des simples photos de famille du cadet en œuvre, on pourrait regretter qu’on fasse passer un grand compositeur pour un simple photographe du dimanche, mais au contraire en utilisant pour appui l’intimité des frères, l’exposition multiplie les indices et permet de voir les tableaux sous un nouvel angle, sous l’angle de la fraternité mais surtout sous celui de la famille, consolidant ainsi l’image d’un peintre fortement imprégné de son monde et qui peignait ses proches, sa ville, ses passions, non pas par égoïsme ou par autosatisfaction, mais avec humilité et bonté. Cela donne une nouvelle dimension à un peintre que Zola voyait comme un bourgeois « anti-artistique » dont les tableaux n’étaient justement que des photographies.
Quand le « Moi au balcon » de Martial en 1891 répond par exemple au « Homme au balcon » de Gustave en 1880, on sent la complicité, l’hommage mais aussi fait rare à la fin du XIXème combien la peinture peut influencer la photographie et non l’inverse. Zola avait raison mais il sous-estimait la force de la peinture comme photographie et c’est ce que Martial semble chercher à souligner. C’est ainsi parfois grâce aux photos qu’on réentrevoit la beauté des toiles de Gustave Caillebotte et leur supériorité face au réel avec des cadrages ambitieux (« Le boulevard Haussman sous la neige », « Le pont de l’Europe ») et un goût pour les contrastes lumineux (« Canotier au chapeau haut de forme »).
Il y a une toile qui résume tous les thèmes et toute la passion de Gustave Caillebotte : « Autoportrait au chevalet ». Il y travaille sous le regard de trois publics : Martial, son colocataire de l’époque, « Le Moulin de la Galette » de Renoir accroché au mur et inversé par le miroir, et le spectateur. On le voit alors tel qu’il est : peintre, frère et mécène. Et malgré tout son talent, on le perce comme un homme qui a toujours l’humilité de se considérer à la croisée des chemins, un artiste pour qui la famille et les autres artistes étaient tout aussi (voir plus) important que son propre travail.
Note : 8,5/10