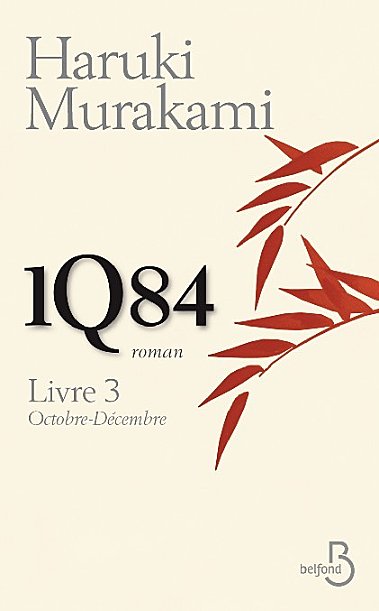Ce texte dévoile une grande partie de l’intrigue du roman, et il est préférable d’avoir terminé celui-ci avant de le lire.
* Le roman universel *
Dans 1Q84, Haruki Murakami continue de proposer sa vision d’un roman universel. 1Q84 est une œuvre sans frontière de par ses références culturelles – rien n’y est spécifique au Japon et les références s’étendent de Proust à Janácek, en passant par Jung, Dostoevsky et forcément Orwell –, de par les genres qu’elle aborde (roman contemporain, SF, histoire d’amour…) et enfin de par les thèmes qui la cimentent. Ici il n’y est jamais question de race, de nation ou de particularisme régional : le monde de 1Q84 est habité de personnages qui ne partagent que des problématiques transverses à l’intégralité du monde : les souffrances infligées aux femmes par les hommes (malheureusement, par nature, le plus petit dénominateur commun des tourments humains), le rejet des gens au physique difficile, les difficultés à trouver sa place dans la société, et évidemment les questions de l’amour.
Reiichi Miura a dit en 2003, peu après la publication de Kafka sur le rivage : « Les romans de Murakami montrent sur le plan esthétique ce qu’il advient de la littérature en ces temps où la mondialisation érode la souveraineté nationale », et c’est encore plus vrai aujourd’hui. Haruki Murakami n’est plus un écrivain japonais, c’est un écrivain du monde qui travaille sur l’entier et non sur la partie. On a toujours senti chez Murakami cette rupture avec son pays d’origine, et c’est dans La Fin des temps, explique Miura, qu’il s’en justifie le mieux : là, il expose le paradoxe du pays natal, cet endroit où l’on sait que l’on aura toujours ses attaches tout en passant sa vie à chercher à se libérer de celle-ci.
Haruki Murakami serait-il alors le démon qui annonce un lissage généralisé des aspérités ? De nombreux auteurs japonais, Kenzaburô Ôé en tête, ont l’air de le penser. Mais il n’est pas surprenant que la sphère littéraire du Japon – pays, encore habité par un nationalisme puissant, qui refuse d’admettre qu’il puisse un jour s’être fourvoyé (à ce sujet, toute visite au mémorial d’Hiroshima est édifiante, tant à aucun moment le rôle du Japon dans la seconde guerre mondiale n’est évoqué ; on ne parle des japonais qu’en victimes) – se méfie de Murakami et l’envisage comme un apôtre du colonialisme culturel américain. Même si l’on peut considérer que c’est un coup bas de la part d’une littérature qui s’est construite uniquement sous l’influence des autres (influences britanniques, françaises et russes) de reprocher soudainement à un auteur de perdre son identité japonaise, ces craintes sont finalement d’actualité. Le fait que Murakami soit l’un des rares écrivains nippons à être issu du jun-bungaku, mais à complètement se désintéresser de l’histoire du pays et à ne pas être hanté par le spectre de la guerre, de la défaite et de la tragédie nucléaire, explique grandement cette hostilité, et pose pas mal de questions sur l’évolution de la littérature japonaise. Mais il s’agit d’une hostilité qui est plus générationnelle que culturelle. Dans un siècle, ce clivage n’aura plus aucune importance. Murakami le sait et c’est pour ça qu’il vise déjà à l’universalité. Je dis bien « universalité » et non « américanisme » (il est plus légitime de condamner le second que le premier) : cette universalité, elle découle pour moi d’un rapport total au monde et non d’un attachement strict au roman américain. L’universalité est ici directe et ne passe par le filtre de la culture américaine (même si celle-ci reste évidemment une composante).
Bien sûr, cette quête du roman mondial pose autant de problèmes qu’elle n’en résout. A vouloir donner une résonnance globale aux choses, on finit par transformer les colorations d’un lieu en simple anecdote et à dépeindre les personnages avec des clichés universels (Tengo est ainsi présenté de la manière suivante : « Pour lui, écrire, c’était comme respirer »). Qui plus est, Philip Gabriel, traducteur de 1Q84 aux Etats-Unis, dit du style qu’il est direct et rationnel, un moyen de dire qu’il est plus impersonnel que par le passé. Et si on ne sait quel est le poids du style vs celui des problèmes de traduction, il est vrai qu’on s’étonne parfois de certaines constructions (cf ce « Et ce jour-là, on aurait dit qu’elle ne se souciait pas beaucoup de ce que son état de fatigue soit aussi flagrant » au début du livre 2)
* Un objectif sibyllin *
Comme La Chrysalide de l’air, le roman dans le roman, 1Q84 souffre souvent de n’être qu’un conte qui ne rentre jamais dans le détail et qui reste à la merci d’idées que Murakami semble incapable de développer. Prenons l’exemple des Little People, ces entités divines qui génèrent mille interrogations tout au long du livre : au final que saurons-nous deux à part qu’il s’agit de mini-hommes au savoir infini qui chantent en travaillant ? On ne connaitra ni leurs motivations ni leurs origines. Incarnent-ils une entité maléfique ? Comment choisissent-ils leurs messagers ? Quels buts poursuivent-ils ? Tout cela restera en suspens comme si Murakami, lui-même, ne savait pas pourquoi il avait introduit ces personnages qui se contenteront pour toutes lignes de dialogues de « Oh Oh ». Pourquoi ? Dans quels buts ? Voici des questions qui reviendront souvent une fois le livre 3 terminé (pour être honnête, j’ai même pendant un moment supposé qu’il y aurait forcément un livre 4). Un décalage profond s’installe alors entre la manière dont Murakami développe en profondeur chaque point qu’il aborde – les histoires des personnages, les descriptions de leur vie quotidienne, des plats qu’ils mangent, des vêtements qu’ils portent – et la façon dont il se défausse des principaux mystères de son histoire (Quid du mystérieux collecteur de la NHK ? Simple incarnation du père ?). Instinctivement, on se doute que tout ça est motivé par un choix et que c’est en toute conscience que Murakami évite l’affrontement frontal avec la partie la plus SF du roman ; mais ce choix on en saisit jamais le sens. Comme le souligne Janet Maslin, en paraphrasant le thème des percepteurs et des receveurs (une des nombreuses questions qui restera en suspens et dont la finalité ne sera jamais connue), Murakami perçoit et nous recevons, « and the reception isn’t all that clear ».
On peut ainsi parfois s’interroger sur les motivations profondes de 1Q84. On sent l’envie de livrer une œuvre à mi-chemin entre le roman contemporain d’exception et le roman de gare, quelque-chose qu’on pourrait à la fois passer des heures à analyser, et à la fois lire peinard sur la plage en sirotant un cocktail. Ce qui frappe le plus est une fois encore l’universalité, non pas cette fois l’universalité des thèmes, mais l’universalité de la cible. Du critique littéraire au lecteur du dimanche, 1Q84 s’adresse à tout le monde : c’est évidemment une grande force, car de tels romans détruisent les barrières, suppriment le cloisonnage et ridiculisent les thèses élitistes, mais est-ce qu’une telle volonté de rassemblement constitue en soi un objectif littéraire valable ? En quoi 1Q84 était essentiel à son auteur ? Quelle facette de l’écrivain qui n’avait jamais été exploré avant propose-t-il ici ? De par ses imperfections, de par son côté inachevé, 1Q84 ne représente pas la quintessence du travail de Murakami ; au contraire certains pourraient même le trouver redondant une fois mis en perspective de ses précédentes œuvres.
* L’amour et la solitude *
Du coup, pour expliquer la forte empreinte que 1Q84 laisse dans l’esprit (car indépendamment de ses nombreux défauts, c’est un livre qui marque énormément), on accepte tel quel le projet de Murakami : faire un bestseller qui ne répondrait in fine à aucune des attentes du lecteur et qui ne résoudrait rien. Comme avec Lost, admettons que le voyage soit plus important que la résolution. On s’attache alors à cette phrase tiré d’un des passages d’Ushikawa : « Si un phénomène avait une existence manifeste – qu’il y ait à cela des causes rationnelles ou pas, logiques ou pas – il lui fallait l’accepter dans sa réalité ». Comme s’en explique souvent Murakami, il faut accepter que nous vivons dans un monde tellement faux et bizarre que peu importe si nous le substituions par un autre ; oui peu importe le cadre, l’humanité des personnages reste la même – un parti pris très fort chez Murakami qu’on entrevoyait déjà dans Le Passage de la nuit.
Dans ce cas l’intérêt pour 1Q84 devient alors motivé par deux thèmes très forts : la connexion surnaturelle qui existe entre Tengo et Aomamé, comme vision d’un amour absolu inscrit dans le subconscient de l’enfance, et le thème de la solitude ; ces deux thèmes finissant par faire écho à la question de l’universalité du roman. Les histoires d’amour ont toujours constitué la première brique de la littérature, et à partir de cette base simpliste et balisée qu’est la rencontre entre une fille et un garçon, Murakami va complexifier son récit au maximum afin de retarder le plus longtemps possible une rencontre attendue depuis les premières pages : pour enfin se retrouver Tengo et Aomamé devront se perdre dans un monde parallèle, un monde parallèle dont la seule justification existera dans sa capacité à justement permettre cette rencontre. On retrouve la notion de trajectoire et de destin de Kafka sur le rivage tandis que le triangle amoureux des Amants du Spoutnik est ici remplacé par la réciprocité des sentiments et par la mise en avant des freins qui sont extérieurs à ceux-ci.
Ensuite, vient la thématique de la solitude. Dans ce roman qui vise l’universalité, le principal trait de caractère commun à tous les personnages vient de leur rapport à la solitude : Tengo est un écrivain solitaire qui se contente d’un rien ; Aomamé n’a que peu d’amis et arrive, sans difficulté à vivre isolée ; Ushikawa a toujours préféré travailler seul, y compris lors de longues périodes de planque ; Tamaru est également un loup solitaire ; Fuka-Eri vit dans une bulle intérieure ; le Pr Ebisuno-sensei se contente de son existence, seul dans les montagnes ; Komatsu ne vit que pour son travail avec de rares contacts avec ses collègues ; même le leader vit finalement à l’écart de la base de la secte. Mais 1Q84 ne traite pas des ravages de la solitude comme tragédie de notre monde moderne. Au contraire, tous les personnages sont seuls, mais semblent éprouver du plaisir (ou du moins un contentement) dans cette solitude. On notera aussi qu’ils ont tous connu des soucis d’intégration à l’école et ce quelque-soit leur popularité initiale. Il y a ici une vraie récurrence des plaisirs frugaux. Aomame comme Tengo aiment la routine de leur vie quotidienne. Peu importe le contexte, peu importe qu’ils soient face au champ des possibles ou prisonnier d’un appartement, les personnages définissent un planning de vie et s’y tiennent (confère lorsque Tengo se retrouve dans la Ville des Chats). Exercice, lecture, travail, repas et sommeil, voici comment se décomposent leurs journées, et comment ils y trouvent de la satisfaction. Mais cette satisfaction n’est-elle pas factice ou guidée par une faute de mieux ? Tous les chapitres de 1Q84 sont associés à un seul protagoniste, sauf le dernier qui affiche fièrement « Aomame & Tengo » comme la seule et unique résolution aux interrogations que nous nous posions.
Ce qui est intéressant, c’est que malgré la solitude des personnages, 1Q84 est un roman hanté par les regroupements : les précurseurs, les témoins, l’organisation de la vielle femme ; tout tourne autour de l’idée de structures sectaires qui sous l’idée de rassemblement sépare en réalité encore plus les gens. Sans être novatrice, la perspective est discrète et particulièrement bien amenée, et donne une nouvelle résonnance à la question de l’universalité. 1Q84 ne serait alors pas un monde parallèle, ce serait notre monde, et 1984 serait notre destination ; un endroit où les regroupements n’existent plus et où l’on ne s’enferme plus dans la solitude par nécessité.
>> Références
– Comment Murakami a conquis le monde par Didier Jacob
– Article de Reiichi Miura dans l’Electronic Book Review, disponible dans Le hors-série de Books : « Tour du monde des bestsellers »
– A Tokyo With Two Moons and Many More Puzzles By Janet Maslin (NY Times)