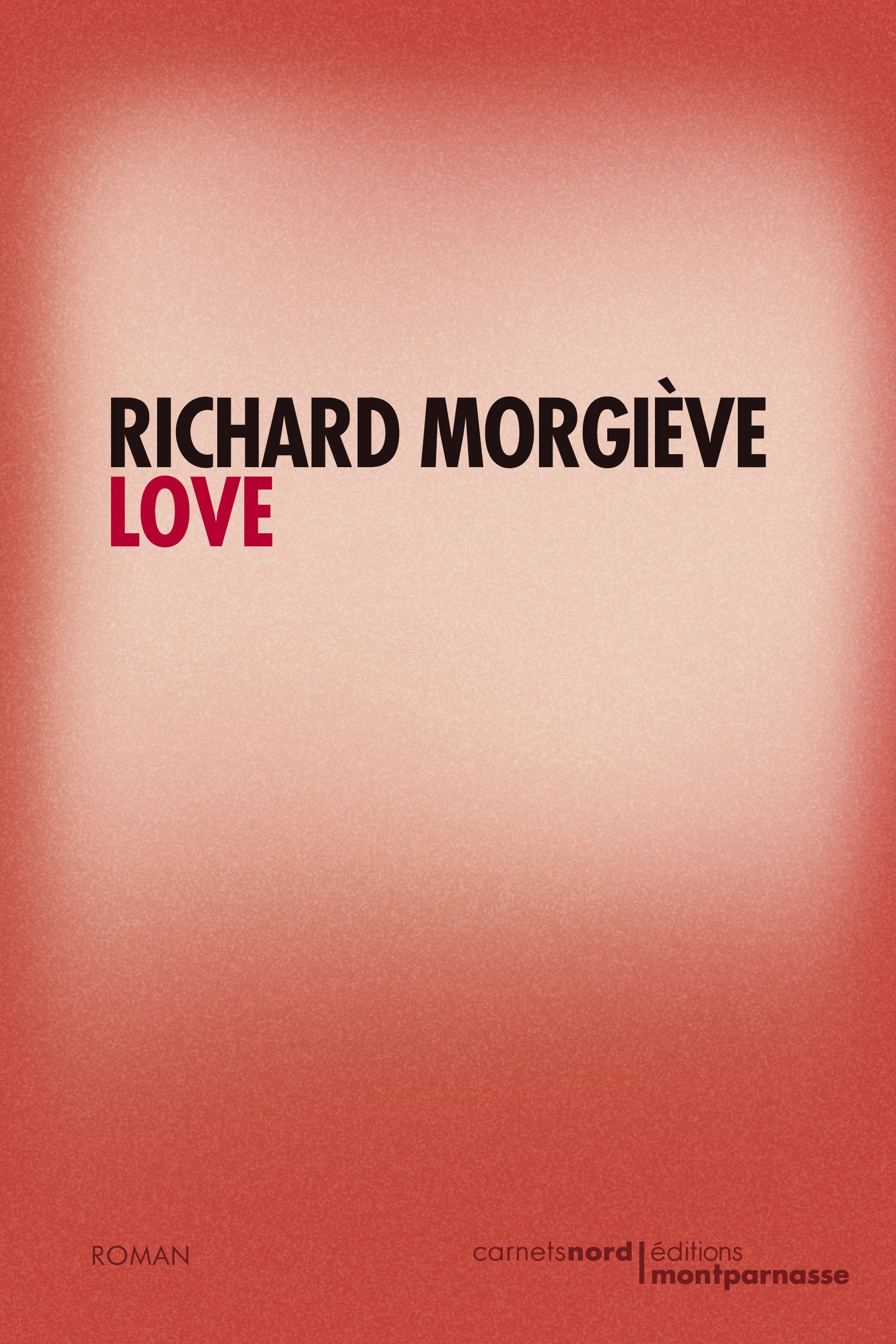Il y a quelque chose que j’aime dans les romans apocalyptiques. Et ils semblent, aujourd’hui plus que jamais, être annonceurs d’une issue qui plane, menaçante, au-dessus de nos têtes. Il y a les zombies et les épidémies foudroyantes, il y a les guerres de religion et il y a la version de Morgiève, plus floue, certainement plus juste, qui évoque un grand bordel (nucléaire en grande partie) et puis plus rien. Le chaos dans l’absence de télécommunications. Le grand silence des télévisions et des radios qui crée une angoisse telle que les hommes ne sont plus capables que du pire.
Après la réalité virtuelle de Boy, Richard Morgiève s’attèle à une autre réalité. La réalité des corps, des vices, de la survie. La réalité du savon pour se laver dans la neige, des animaux que l’on doit apprivoiser à nouveau et des hommes qui se comportent comme des animaux.
Il y a l’homme-machine, bras armé d’une organisation secrète européenne, qui a une mission et puis il y a la fille. Cette fille sans nom est un peu une machine et l’homme qui tombe amoureux d’elle s’appelle Chance. Alors il y a de bonnes raisons que leur histoire en soit empreinte un peu. L’histoire se passe aujourd’hui, dans une France que l’on connaît, au moment de la fin du monde. Mais l’homme-machine n’est pas là pour sauver le monde. Il croise la route de celle qui le fait devenir un homme et c’est une toute autre histoire qui commence.
L’auteur a ce talent dans l’écriture qui donne un goût et une odeur aux moindres petits détails, de la carcasse de lapin dans laquelle on mord et dont le sang gicle dans la bouche, aux pis de vache sales qui produisent un lait épais. De la barbe touffue de Chance aux cliquètements des conserves choisies au hasard pour faire une soupe qui réchauffe. C’est le plus dur, je crois. Celui de donner à voir avec les yeux, de faire toucher, goûter et sentir cette humanité triste qui s’éteint au travers de détails qui agressent.
Parce que quand il ne reste plus rien, ce sont ces détails qui restent. Ces détails qui sont tout. Comme un briquet dont on ne sait pas combien de temps il va durer, le dernier livre que l’on aura voulu avoir entre les mains, quelques gouttes d’eau dans une bouteille en plastique oubliée sur le siège arrière d’une voiture. Ce sont ces détails stupides qui deviennent la réalité, parce qu’il n’est plus question que de survie. Une survie qui n’a de sens que celui qu’on lui donne, qu’il soit celui de retrouver un être cher, de rencontrer l’amour, de régler ses comptes avec la société ou de détruire tout ce que l’on peut avant que quelqu’un d’autre ne le fasse.
Une fois encore, l’auteur aura réussi à me couper le souffle. Dans la première centaine de pages, les mètres et les kilomètres parcourus par Chance sont rythmés par mon propre halètement. J’ai le souffle court, la respiration alourdie par l’air vicié de la fin du monde. À ce stade de l’histoire, Chance n’est encore qu’une machine, une machine qui doute certes, et son parcours a des airs de course contre la montre. Non pas une course pour la survie mais dans le but de retrouver celle qu’il aime. D’un amour comme on en voit chez Barjavel ou dans les contes d’antan. Il ne sait ni son nom, ni la couleur de ses yeux mais c’est elle.
Contrairement aux héros de Barjavel dans La nuit des temps, les héros de Morgiève sont désespérément humains. C’est-à-dire qu’ils produisent des excréments, qu’ils violent ou se font violer, qu’ils ronflent ou encore qu’ils sont crasseux. Pourtant, la pureté de leur amour les sauve. L’aveuglement de l’amour de Chance, les sentiments naïfs et confus de la fille les sauvent. C’est quelque chose qu’ils préservent envers et contre tous, quelque chose qu’ils réussissent même à ne pas salir. Par des gestes simples, dans des conditions extrêmes, ils s’aiment.
Quand ces deux-là sont réunis, je prends une grande bouffée d’air puant et je me prépare au pire. Mais c’est sans compter sur la bienveillance de Morgiève, son amour profond pour ses personnages et son espoir, même s’il est ténu, pour un avenir meilleur. Peut-être faudra-t-il tout casser pour en arriver là, mais ça en vaudra la peine.