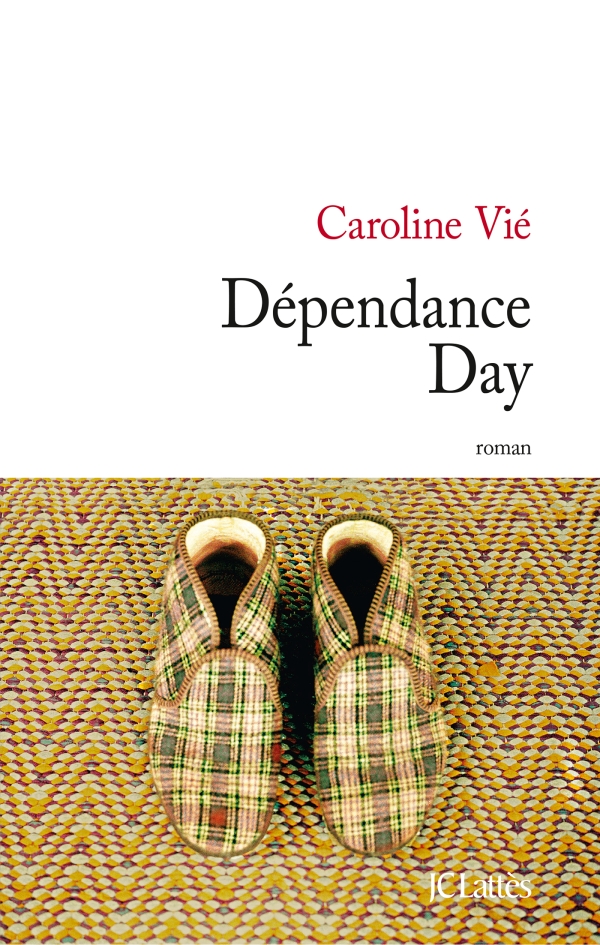On ne prénomme pas impunément Morta l’héroïne à la première personne de son roman. Surtout quand son aïeule est baptisée Lachésis, et sa mère Clotho. Comme les Parques, en version grecque ou latine, ces trois sœurs qui tissent, filent et coupent la vie des humains, ministres du Destin et chargées d’exécuter ses ordres, dans toute leur inexorabilité. Et qu’elles soient familièrement surnommées Mortadelle, Lala et Cloclo n’y change rien : on est ici dans le registre du tragique.
Le destin, de nos jours, n’est plus une obscure divinité. Il emprunte son patronyme à un médecin allemand : Alzheimer. Dès la première phrase du livre, Morta énonce : « Je ne vais pas bien. » On la comprend. Elle est dans le cabinet moche d’une neurologue, à guetter en elle les signes de la maladie. Adolescente, elle a assisté au déclin de Lachésis. Adulte, ça a été à elle de placer à son tour Clotho, après que celle-ci a basculé de l’autre côté. En ayant la certitude, à tort ou à raison, qu’elle n’échappera pas à cette fatalité qui touche les femmes de sa lignée. Pas de suspense à attendre. Dépendance Day peut se lire comme un enlisement progressif dans les sables mouvants de la perte, des autres puis de soi, ou la chronique d’une démence annoncée.
Pour conjurer le sort qui la condamne à perdre la mémoire en même temps que sa dignité, l’héroïne, et Caroline Vié avec elle, se raccroche aux détails. À des instants captés au vol. Entre deux moments d’angoisse, Morta se raconte en creux. Auteur de roman policiers reconnue, bonne épouse, bonne mère, elle vit sans excès, sans passion. Raisonnable. Une femme de devoir, comme on disait. Surtout, elle observe le monde autour d’elle avec l’intensité de celle qui sait que tout va disparaître. Et ressuscite sa parentèle au fil de ses souvenirs, dans un jeu constant entre un présent qui se décale et le passé. Avec autant de lucidité que de nostalgie, et non sans tendresse. C’est une des réussites de ce roman de trouver le ton juste pour brosser le portrait d’une excentrique famille petite-bourgeoise à la grande époque du Programme commun, d’un regard amusé mais sans tomber dans la caricature. Le père, « issu d’école catholique avant de devenir communiste pratiquant », féministe en théorie, est surtout occupé à courir les jupons. La mère, aspirante danseuse étoile, s’est résignée à devenir enseignante d’espagnol et fidèle soutien du peuple chilien éprouvé après le coup d’État de Pinochet. Elle ne se laissera aller qu’une fois à pratiquer à son tour le mariage ouvert. Sans vertige. « L’adultère avait pour elle l’odeur de la lessive et la saveur du petit-salé aux lentilles. » On sent entre elle et Morta une complicité profonde qui ne se paie pas de mots.
Mais cela n’est sans doute pas l’essentiel du roman, dont les pages les plus fortes décrivent de façon sèche, clinique, quasi documentaire, la maladie, dans toute sa trivialité et son indécence. Son arrivée, brutale ou insidieuse. Avec l’aveuglement dont on peut faire preuve lorsqu’elle s’installe, le déni face aux petites choses qui s’accumulent. Des messages téléphoniques sans queue ni tête qui s’empilent sur un répondeur, le coude qui se lève de plus en plus volontiers, une certaine agressivité, l’appartement de moins en moins bien tenu… Des étapes sur la route à sens unique de la dégradation de la conscience. Avec la levée des inhibitions, le corps qui s’affiche dans toute l’obscénité de ses désirs. Puis l’aide à domicile, les sévices, le placement, et les joies des maisons de retraite et des hôpitaux. Jusqu’au dernier souffle : « Si on dit “retomber en enfance”, c’est parce que la chute est douloureuse et qu’on ne s’en relève pas. » Mais Alzheimer, c’est aussi toutes les répercussions sur les proches, le désarroi, la paperasse, les formalités. Et l’horreur de se prendre en pleine face l’intimité de ses parents.
Pas question pour autant pour Caroline Vié de se laisser aller au simple témoignage, même si l’on peut deviner dans la dédicace du livre une part intime, et s’il ne fait grâce d’aucune scène pénible. Car il y a dans Dépendance Day une vraie matière littéraire, une maîtrise dans la construction et les changements de ton, un refus du pathos facile et de l’effet de manche qui passe par un humour très noir. Parce qu’il faut bien ça pour tenir le choc face à l’insupportable, essayer de donner le change. « L’épouvante a cela d’amusant qu’on n’en touche jamais le fond », note Morta, et on peut en dire autant de ce roman atrocement drôle. Jusqu’à ce que le sourire se crispe en rictus.
Pas nécessairement recommandé aux dépressifs, on l’aura compris, ce second roman, pour désespéré qu’il soit – le pire y est toujours sûr – n’en est pas pour autant résigné. Morta ne se dérobe jamais, fait toujours au mieux. Et rappelle que si le propre du destin est son inexorabilité, on peut toujours l’affronter la tête haute, dans la dignité, et sans abdiquer une part de liberté.