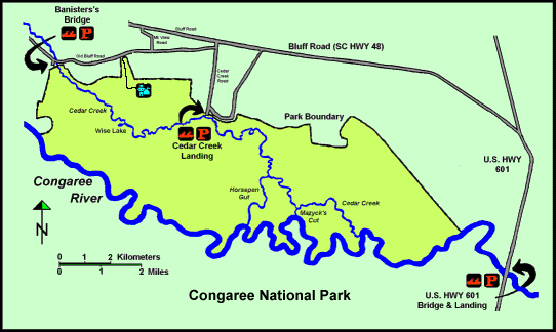Michael Pisaro : la continuité brouillée
« Kingsnake Grey »
Peut-on écouter un coucher de soleil ? Dans la Phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty affirme que oui. « La vision des sons ou l’audition des couleurs existent. […] Ces phénomènes se réalisent comme se réalise l’unité du regard à travers les deux yeux : en tant que mon corps est non pas une somme d’organes juxtaposés mais un système synergique ». Ma capacité à voir ne consiste pas ainsi en un simple « raccordement » des flots de données recueillies par chacune de mes deux rétines. De même, mes capacités générales à ressentir et percevoir ne se résument pas en des « empilements » de stimuli sensoriels hétéroclites, s’excluant les uns les autres et ne découvrant leur complémentarité qu’après-coup. Mes organes sensoriels ne sont pas des engins autonomes. Je suis un. Je suis mes yeux, je suis mes oreilles, je suis mes doigts, je suis ma peau, et ils ne sont que moi.
Je ne fais pas de sous-traitance. Je suis un à chaque instant de ma vie. En fait, je ne cesse jamais de percevoir ou de ressentir, et je ne sais le faire qu’en mobilisant tout mon être. « Dans la perception nous ne pensons pas l’objet et nous ne nous pensons pas le pensant, nous sommes à l’objet et nous nous confondons avec ce corps qui en sait plus que nous sur le monde, sur les motifs et les moyens qu’on a d’en faire la synthèse ».
En face d’un coucher de soleil, je saisis un phénomène total pour lequel je prends parti. Ce n’est pas une carte postale animée. Il est certes impressionnant de voir le soleil s’enfoncer sous l’horizon en submergeant le ciel de teintes étranges, mais nous saisissons encore bien plus, rien que sur le plan visuel : la lune se démasque, la luminosité électrique prend le relai de la naturelle… ; sur le plan tactile aussi, les derniers rayons nous chauffent le visage, l’air rafraîchi nous enserre avec une pression croissante… On peut également éprouver un léger engourdissement du corps, une baisse infime du tonus musculaire. Enfin, et bien que cela paraisse de prime abord assez mystérieux, il y a aussi les modifications que l’on peut entendre. Car le coucher de soleil se produit dans un monde, un monde qui vit selon le cycle des jours et des nuits et se structure en fonction de cette alternance. Alors, au passage d’un état à un autre, les mondes terrestres basculent aussi. Ce que Michael Pisaro tâche de nous montrer est que ce basculement est tout à fait audible.
« Kingsnake Grey » a été enregistré le 31 décembre 2012, à la tombée de la nuit, dans le parc national du Congaree en Caroline du Sud. Michael Pisaro et son acolyte Greg Stuart ont branché leurs micros au moment où le soleil se couchait, puis ils ont attendu 72 minutes sans faire un geste. Le lieu, la date, l’horaire et les modalités d’enregistrement avaient été fixés à l’avance. Ils avaient en outre échafaudé quelques théories, formulé quelques hypothèse. Michael Pisaro s’était imaginé que symétriquement à la chute de la luminosité, le « bruit » naturel allait aussi décroître – que s’évanouissant dans la nuit, l’écosystème local allait lui aussi se mettre en veille. Mais au moment de l’enregistrement proprement dit, Pisaro ne pouvait rien faire, seulement voir ce que le réel allait lui répondre.
Quelque part, les prévisions de Pisaro se sont avérées justes. Entre le début et la fin de ces 72 minutes, et donc entre le coucher de soleil et l’établissement de la nuit, on remarque une baisse générale du volume sonore et une perte de complexité. Au départ, les insectes forment un tapis dense et épais servant de socle au brouillamini des oiseaux. À la fin, les insectes ne renvoient plus qu’une pulsation fragile, lointaine, tandis que les oiseaux deviennent rares et solitaires. De ce point de vue, il est incontestable que la nuit impose son autorité. Fatalement, elle agit.
Cela étant, et bien qu’au final la faune s’exécute, elle ne le fait pas sans quelques poches de résistance. Le mouvement de bascule de la vie diurne vers celle nocturne ne se produit pas de façon uniforme. Elle se fait par série d’à-coups et de fléchissements imperceptibles. On croit entendre la faune qui se tranquillise et donc le soleil qui se couche, et brutalement une masse d’énergie, une agitation indistincte nous induit en erreur ; et lorsqu’au contraire le scepticisme pointe, nous faisant dire que rien ne change, la fièvre diurne tombe alors, mais si discrètement qu’on en discrimine pas les paliers. Donc si le plan sonore se modifie indéniablement avec le coucher du soleil, il ne le fait pas sans nous troubler ni nous tromper. Peut-être notre ouïe n’est-elle pas assez affûtée…
Par ailleurs, ce que Pisaro n’avait pas envisagé – et qui à l’écoute de « Kingsnake Grey » devient flagrant – est le caractère menaçant de la nuit. Quand le jour nous expose à un fond sonore continu qui sollicite en permanence notre vigilance, la nuit, elle, nous donne l’illusion que rien ne pourra advenir – la nature tend vers le silence, les bruits se raréfient, leur intensité diminue. Or quand à nouveau un bruit vif se fait entendre, l’effet de contraste nous saisit. Alors que notre vigilance était déclinante, ce bruit-évènement nous ramène brusquement à notre « responsabilité sensorielle », celle de maintenir notre corps en alerte face à un danger potentiel.
Cette propension innée à anticiper les risques est tout à fait manifeste lorsqu’on écoute attentivement l’enregistrement de Pisaro (quand bien même il ne s’agisse que d’une « simulation de réalité »). Ainsi, une fois la nuit tombée et le calme retrouvé, chaque nouveau son prend une dimension nouvelle. Loin de la saturation auditive du plein jour que nous accueillons activement (et pour lequel nous effectuons un tri entre les sons utiles et inutiles), les évènements sonores de la nuit s’imposent à nous sans alternative. Entourés par le vide, surgissant du flux paisible de la nuit, ils réclament de nous une prise en considération quasi-tragique. On ne peut pas prendre ces bruits à la légère, et on ne peut pas non plus faire l’économie de leur donner un sens. Dans le dispositif imaginé par Greg Stuart et Michael Pisaro, ce « principe de précaution nerveux » est admirablement thématisé. Ce dispositif nous prive du moindre indice visuel ou du moindre contexte interprétatif. De fait, les sons qui nous arrivent nous heurtent complètement. Aucune explication ne vient spontanément les rationaliser. Est-ce un animal ? Est-ce simplement les arbres ? Et comment des arbres pourraient-ils faire ce bruit ? Et cet animal serait-il dangereux ? Seraient-ils plusieurs ? Que voudraient-ils ? Ces questions demeurent sans réponse. Et au final, on ne retient que l’énigme et l’inquiétude dont elle accouche.
C’est ainsi qu’à travers cet enregistrement, Greg Stuart et Michael Pisaro nous invitent à bien plus qu’à écouter placidement un environnement naturel et prévisible. Au contraire, le caractère limité et contre-intuitif de leur oeuvre – à savoir écouter ce qu’on a plutôt l’habitude de voir et de vivre – nous oblige à entrer dans une démarche hautement spéculative. Ici, pour reprendre les mots de Merleau-Ponty, les sens ne communiquent pas. « Le mouvement général de l’être-au-monde » ne passe que par un seul canal, le canal auditif. Dès lors, Stuart et Pisaro nous exhortent à voir avec les oreilles, à sentir avec les oreilles, à nous mouvoir avec les oreilles. C’est une évidence, car « Kingsnake Grey » nous oblige à penser tout un monde à partir de ces petits rien sonores ; et que sont nos pensées habituellement si ce n’est une somme colossale d’images, d’odeurs, de goûts, de plaisirs et de douleurs du corps qui passent aux tamis du langage et du temps ? Et ici, nous devons pourtant nous contenter de simples sons, nous devons reconstruire à partir d’eux tout un univers multisensoriel et réflexif dont nous avons besoin, duquel nous sommes forcément solidaires. Et avec de simples sons, nous n’y arrivons que difficilement. « Kingsnake Grey » nous fragilise et nous rend vulnérable, et il y arrive de la plus discrète et de la plus humble des façons.
« Congaree Nomads »
La deuxième composition du triptyque Continuum Unbound aborde une thématique beaucoup plus directement musicale que pour « Kingsnake Grey ». « Congaree Nomads » est en effet une étude qu’on pourrait dire classique de la part Michael Pisaro, dans laquelle il met en tension deux pôles a priori inconciliables : d’un côté l’amour des singularités et de l’aléatoire, de l’autre une foi indéfectible en la mathématisation et la structuration formelle de la musique.
Reprenons le processus par lequel a pu germer « Congaree Nomads ». Nous sommes toujours dans le parc national du Congaree, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Columbia. Entre le 30 novembre 2012 et le 02 janvier 2013, c’est à dire lors de la même session d’enregistrement que pour « Kingsnake Grey », Greg Stuart et Michael Pisaro recueillent 24 vignettes sonores de 3 minutes, à des heures et des jours différents, mais en suivant un itinéraire prédéterminé — partant du parking et du ruisseau de Cedar jusqu’à l’imposante rivière Congaree.
24 * 3 donnant 72 minutes, nous avons de cette manière la trame « naturelle » de cette composition. Les vignettes de 3 minutes sont mises bout à bout selon leur ordre géographique – du Cedar Creek vers Congaree River. Chaque séquence est mixée avec des longs « fade in » et « fade out », de manière à ce que, par période de 3 minutes, soit les sons naturels sont totalement absents, soit ils sont à leur volume maximum. Sur ce montage de sons naturels ponctués de plages silencieuses, Michael Pisaro va écrire une partition pour vibraphone, glockenspiel et crotales qu’interprétera ensuite Greg Stuart. Cette partition est également structurée en 24 séquences de 3 minutes et elle inclue des indications concernant la répétition des sons, leur niveau vibratoire et le nombre de pistes d’enregistrement autorisées. Schématiquement, ces indications augmentent graduellement à mesure que les séries de 3 minutes se répètent. L’interprétation de Greg Stuart et la trame naturelle initiale de 72 minutes sont enfin superposées et considérées comme une entité unique.
Une telle méthode de composition pourrait laisser à penser que « Congaree Nomads » est un exercice de style à la portée uniquement intellectuelle. Fort heureusement, Michael Pisaro arrive toujours à nous concerner émotionnellement. Ici, cela tient à deux choses. Premièrement, à la variété et l’infinie complexité des sons naturels captés. Au sein ce cette structure rigoriste, cyclique et dont tous les paramètres sont contrôlés, pointe une suite de 24 inconnues. 24 nébuleuses sonores naturelles qui sont, elles, impossibles à manipuler. Qu’il s’agisse du son produit par une nuée d’oiseaux ou bien par l’écoulement de l’eau contre des rochers, à chaque fois il s’agit de phénomènes singuliers, de systèmes dit chaotiques accordant une grande multiplicité de degrés de liberté internes. Et ces 24 masses sonores aux détails imprédictibles constituent au sein de « Congaree Nomads » une forme de contrepouvoir. Michael Pisaro fait avec. Il bâtit une composition automatisée au sein de laquelle il préserve des zones d’autonomie, des espaces où la complexité naturelle reste souveraine. À écouter, cela nous interpelle. Surtout dans la dialectique pour partie aléatoire qui s’instaure avec les grilles harmoniques posées par le compositeur. Et c’est là le deuxième élément qui entre jeu pour que Congaree Nomads soit un morceau qui nous tienne à coeur. Ces zones d’autonomies sonores sont mises en résonance avec une production sonore qui est certes mathématique, mais aussi et surtout humaine.
Michael Pisaro est un artiste qui s’intéresse quelque part à l’arithmétique des sentiments. Je ne pense pas qu’il envisage l’homme comme un simple et implacable système de traitement de l’information, néanmoins une question l’obsède : qu’est ce que la mathématique peut produire en nous ? Ainsi, quand il organise ses créations selon un nombre précis de variables dont les mouvements sont normalisés, il ne vise aucun message politique comme ont pu le faire les sérialistes et les industriels, de Stockhausen à Throbbing Gristle, il cherche au contraire à produire une émotion. Une émotion qui est le produit d’une mécanique formelle particulière. Au fond cette émotion n’est pas un réflexe – il y a toujours des facteurs historiques personnels qui rendent notre capacité à nous émouvoir aussi complexe et imprévisible que le bruit détaillé d’une cascade. Et pourtant malgré cette part d’impondérable singulier, une détermination générale existe. Les structures répétitives de Michael Pisaro appliquent en nous un certain rythme perceptif. Elles nous imposent certaines conditions de possibilité d’être ému ou non. Or, en plus de cette dynamique temporelle qui nous assujettit, Pisaro joue également sur des effets de gradation : volumes qui s’élèvent, nombre de pistes qui se décuplent en des harmonies toujours plus enveloppantes, successions tonales de plus en plus mélodiques. Et ce double jeu de périodicité rythmique et d’intensification progressive des variables concoure vers un romantisme inédit à l’effet maximal. Autrement dit, par des procédures strictes et minimalistes, Michael Pisaro parvient à toucher notre corde sensible.
Par ailleurs, comme nous l’avons introduit précédemment, ce lyrisme mathématique de la partition entre en dialogue avec les complexes sonores naturels enregistrés dans le parc du Congaree. Ces associations impliquent une nouvelle série d’effets produits sur nous qui sont de tout ordre. À certains moments, ces deux strates sonores semblent se contredire – par exemple une nature d’apparence calme accompagnant des accords stridents, ou à l’inverse un vacarme naturel chevauchant des nappes relaxantes. D’un autre côté, ces deux strates semblent aussi aller parfois dans le même sens, agissant de concert pour nous impacter de manière coordonnée. À ce propos, je ne sais pas dans quelle mesure Michael Pisaro a construit intentionnellement ce dialogue. Il n’est pas adepte de l’improvisation, donc je ne l’imagine pas « tenter » des accords de vibraphone ou de glockenspiel en écoutant ses 72 minutes de field recording. Le plus probable est qu’il ait écrit sa partition à part, sans souvenir exact de ce qui constituait sa trame enregistrée dans le parc. Après tout, seul importait qu’il y ait une structure de correspondance entre les deux, à savoir 24 parties de 3 minutes. Dès lors, une correlation rythmique existait quoiqu’il arrive, et Pisaro pouvait écrire sa partition sans penser du tout à la trame naturelle qui l’accompagnerait. Il est par conséquent très possible que dans « Congaree Nomads », toutes les interactions entre sons naturels et notes instrumentales soient arbitraires, et que les émotions produites par ces interactions soient dues au hasard, et ce bien qu’intuitivement, on leur fixe un certain degré d’intentionnalité.
On voit ici poindre l’ambiguité fascinante du travail de Michael Pisaro. Son désir de nous proposer une musique belle et émouvante est tiraillée par un doute épistémologique central : la question de l’origine de cette beauté. Doit-elle être une captation naturaliste, un construit culturel, un domptage de phénomènes sonores indéterminés ? Pisaro hésite, prend ce problème par tous les bouts, et choisit finalement la solution d’une musique parfaitement hybride, faite à part égale de contingence et de raison pure. Ce n’est pas une façon de se défausser, mais bien au contraire dans nous amener avec lui dans sa spirale interrogative sans fin.
« Anabasis »
Les trois compositions de ce projet de Michael Pisaro sont réunis sous le titre Continuum Unbound. C’est en quelque sorte un titre programmatique : il expose le concept philosophique qui relie l’ensemble, et que chaque composition va décliner à sa manière. « Continuum Unbound » signifie « continuité brouillée », et renvoie à la tension qui peut exister entre liaison et déliaison, fluidité et rupture. Dans « Kingsnake Grey », cette tension se manifestait dans le mouvement lent et heurté d’installation de la nuit. Dans « Congaree Nomads », elle était à l’oeuvre dans la dialectique entre formalisme mathématique et désordre naturel. En ce qui concerne « Anabasis », cette tension se déplace encore sur un autre terrain. Ici, la continuité questionnée est celle de l’inspiration musicale, entre d’un côté une pratique instrumentale qu’on pourrait dire abstraite mais qui imite la nature de manière tout à fait nouvelle, et de l’autre un exercice musicale plus classique et confortable mais dont les principes de fondation se donnent néanmoins à être interrogés.
Avant de poursuivre cette réflexion, décrivons d’abord le morceau en lui-même. Déjà, il s’agit d’une composition qui est essentiellement jouée par des musiciens. Quelques traces d’enregistrement naturel peuvent subsister, mais de façon anecdotique. Trois musiciens interviennent en plus de Greg Stuart et Michael Pisaro : Patrick Farmer, Joe Panzner et Toshiya Tsunoda. Ces cinq musiciens sont présents sur l’intégralité du morceau, quoique leur rôle évolue drastiquement selon les parties. Le morceau est effet découpé en 4 sections principales entrecoupées de 4 interludes. Chaque section dure 15 minutes et se divise elle-même en 5 sous-unités de 3 minutes. Pour chacune de ces sections, un musicien est plus particulièrement mis en avant. Toshiya Tsunoda est lui responsable des différents interludes.
En ce qui concerne l’instrumentation utilisée, mystère. Aucune info n’est donnée à ce sujet, et à écouter, il est bien difficile de se faire une idée précise. Disons seulement que les musiciens utilisent un vaste appareillage électro-acoustique, qui mêle manipulations réelles et traitement informatique. De toute façon, le rôle de chacun n’est pas défini selon les outils qu’ils utilisent, mais selon la matrice sonore qu’ils doivent prendre pour référence. Ainsi, Greg Stuart articule son interprétation autour du « sable », Patrick Farmer exploite les possibilités offerte par le « vent », Joe Panzner travaille sur les « vagues », et Michael Pisaro s’intéresse quant à lui à la notion de tonalité – une notion tellement commune qu’il est d’ailleurs déstabilisant de la voir réifiée de la sorte. Toshiya Tsunoda joue quant à lui chaque rôle successivement.
La musique jouée dans « Anabasis » est donc constituée par 4 dimensions – ton, sable, vent et vague – qui évoluent en fonction de la structure temporelle du morceau et des indications écrites par Pisaro concernant la durée et l’intensité des sons joués. Ces aspects formels ne constituent cependant qu’un balisage insuffisant pour les musiciens, il leur revient la charge d’en déterminer les manques, notamment en ce qui concerne les timbres. De même, les interventions des accompagnateurs sur chaque section ne semblent pas fixées à l’avance.
Une première remarque sur ce processus : Michael Pisaro ne fait pas de choix entre tonalité et atonalité. Il intègre le ton comme un paramètre parmi d’autres. Dans sa section principale, de la 36ème à 51ème minutes, il égrène quelques notes de piano fatiguées. Ça et là, on décèle quelques suites d’accords en arrière-plan. Et puis pas grand-chose de plus… Ces bribes tonales n’ont ni plus, ni moins de valeur dans « Anabasis » que les sons granulaires et sableux joués par Greg Stuart, ou que les ondulations de Joe Panzner. Cette relativité nous trouble : la tonalité n’y est pas vu comme un système qu’on approuve ou rejette en totalité, mais comme une possibilité qu’on peut utiliser partiellement et de manière transitoire.
Que nous disent ensuite ces bribes de tonalité ? Elles nous renvoient à une culture musicale disons traditionnelle, incluant la musique classique et la majeure partie des musiques actuelles. L’harmonie tonale est en fait le socle de ce que nous apprenons être de la musique : en clair, dans notre France actuelle, c’est l’éducation tacite au système tonal qui nous fait dire ce qui est musical et ce qui ne l’est pas. Or, bien que ces principes harmoniques aient colonisé nos esprits, ils n’en demeurent pas moins des principes conventionnels, qui peuvent être mis en concurrence avec des systèmes non occidentaux ou alternatifs. C’est quelque part ce ce que fait Michael Pisaro, qui ne met certes pas en concurrence mais qui agrège, au sein d’une même composition, des éléments issus de doctrines différentes.
La « continuité brouillée » d’Anabasis tient en cette espèce de fondu musical entre musique tonale et atonale. Dans ce continuum, les harmonies tonales et les motifs mélodiques de Michael Pisaro surprennent. Leur caractère isolé et minoritaire mettent en lumière leur origine factice : ils ne sont qu’une fabrication culturelle dont on peut tout à fait questionner les fondements. Car si le reste du morceau est certes gouverné par des principes atonaux supposés être inconfortables, ces expériences sonores ont une valeur expressive qu’on apprivoise très facilement. Cela tient à leur visée imitative de la nature. Ainsi, Greg Stuart, Patrick Farmer et Joe Panzner produisent peut-être des sons très inhabituels pour le champ musical, mais ces sons rappellent immédiatement des phénomènes sonores que nous connaissons tous : pluie, vagues, bourrasques etc., ce qui les rend aisément accessibles pour notre sensibilité. Nous nous dégageons de fait de tout impératif tonal pour accueillir à la place une musique-simulacre, qui par la main de l’homme et grâce à des outils technologiques, tente de reproduire les bruits naturels du monde tels qu’on peut les entendre dans « Kingsnake Grey », dans « Congaree Nomads », ou bien sûr dans notre vie personnelle.
Musique et nature ont noué au fil des siècles des liens ambivalents. Comme nous l’avons dit précédemment, la musique classique s’est bâtie sur des principes conventionnels. Elle s’est développée dans un cadre philosophique où l’on distingue fermement nature et culture d’un côté, corps et esprit de l’autre. La musique, elle, se rangeait sans hésitation du côté de la culture et de l’esprit. Pourtant, la nature n’a cessé d’être un thème de prédilection pour de nombreux compositeurs : « Les Quatre saisons » de Vivaldi, « La Symphonie pastorale » de Beethoven ou les « Scènes de la forêt » de Schumann en sont des témoignages célèbres. Mais ces compositeurs s’intéressaient à ce que la nature représentaient pour eux, pas aux sons concrets qu’elle pouvait générer. La nature, alors, n’était envisagée que sous l’angle du fantasme, du mythe ou du symbole, dans un langage musical qui n’essayait en aucun cas de se calquer au bruissement du monde.
Il faudra un long processus pour qu’en musique, la nature devienne réellement un modèle pratique. Un premier palier fut franchi avec Claude Debussy, qui chercha à s’éloigner de l’orthodoxie académique pour laisser ses compositions s’imprégner des mouvements sonores naturels. « Il faut n’écouter les conseils de personne [disait-il], sinon du vent qui passe et nous raconte l’histoire du monde ». D’autres suivront, avec notamment Olivier Messiaen, qui s’attachera à écrire le plus précisément possible les chants d’oiseaux, ou encore Toru Takemistu, qui dans ses compositions visera à rétablir l’harmonie cosmique du monde. Mais au-delà de ces exemples littéraux, c’est aussi l’ensemble de la musique contemporaine en rupture avec la tonalité qui puisera son inspiration dans le champ naturel. Pour sortir du rationalisme des lumières, des idéaux religieux ou des exubérances du romantisme, la complexité sans sujet des sons naturels marque un horizon nouveau pour toute une génération de compositeurs d’avant-garde. Qu’il s’agisse de Xenakis, de Boulez ou de John Cage, tous ont découvert dans les sciences naturelles de leur temps les raisons et les moyens de renouveler leur art. Leurs contributions à la réflexion musicale concernant le hasard, le silence, l’accident, le rythme et les agrégats sonores sont quelque part indissociables d’un certain regard sur le monde naturel.
Dans le prolongement de ce faisceau d’innovations, Michael Pisaro propose aujourd’hui une manière fraîche et inédite d’aborder les liens dynamiques entre musique et nature. La compréhension des phénomènes sonores complexes permet chez lui l’émergence d’instruments ou de machines électro-acoustiques qui sont imitatives de la nature. Ces outils, dans la définition de leur timbre comme dans leurs possibilités de modulations, essaient en effet de reproduire certains phénomènes sonores évolutifs comme la pluie, le vent ou le frottement des grains de sable. Mais l’approximation de ces synthèses électroniques rend aussi les sons de Greg Stuart, Patrick Farmer, Joe Panzner ou Toshiya Tsunoda tout à fait originaux. Et au final, ils donnent à entendre une nature qui n’existe que dans notre imaginaire. Cet effet est d’autant plus marqué que la structure temporelle d’ « Anabasis » demeure très stricte, avec ses unités de 3 minutes réunies en ensembles systématiques et ordonnés. Le flux naturel du monde est ainsi cassé au profit d’une forme inflexible au sein de laquelle s’expriment des instruments prétendus naturalistes – dont la musicalité est indexée sur des variations sonores naturelles –, mais qui, à aucun moment, n’évoquent pourtant un paysage sonore authentique.
De ce point de vue, Michael Pisaro essaie de s’approcher au plus près du naturel dans un seul but : nourrir un art de la composition qui demeurera quoiqu’il arrive humain et conventionnel. Pour Pisaro, la musique reste un langage, qu’il s’agit de faire fructifier à la manière d’un poète. Si dans « Kingsnake Grey », il laisse la nature parler, que dans « Congaree Nomads » il négocie avec, dans « Anabasis », il ne fait ni l’un ni l’autre ; plus humblement, il nous donne à entendre ce qu’il a compris de la nature – à savoir des sons amples, des textures mouvantes, des variations brusques : en un mot du « continuum unbound ». Pisaro ne pourra jamais jouer le son de la nature et il ne s’en cache pas. Il peut s’inspirer d’elle, mais en ayant conscience qu’elle restera insaisissable. C’est pourquoi en même temps qu’il tente d’imiter la nature, il insiste sur le caractère forcé et intentionnel de sa composition. Il donne à entendre une structure rigide, un codage narratif, et même quelques notes de piano. Car plus on se rapproche de la nature, plus la vérité est éloquente : on reste humain, avec toutes les excroissances bizarres que ça implique – le besoin d’ordonner le réel comme le plaisir à se perdre dans ses pensées.