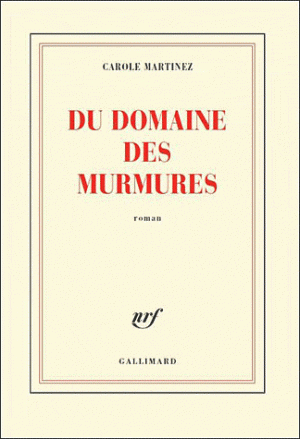La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap

« À tes côtés, je m’émerveille.
Blottie dans mon ombre, tu partages ma couche.
Tu dors, ô mon enfance,
Et, pour l’éternité, dans la tombe, je veille.
Nous sommes mortes à douze ans et depuis, j’ai vieilli, infiniment, à regarder le monde sans en être ».
Le domaine des Murmures est de retour, mon intuition confirmée, Carole Martinez le fera vivre à travers les siècles : deux autres tomes seraient prévus. J’avais adoré le premier « Du domaine des Murmures» et j’attendais impatiemment le prochain livre de celle que je considère comme l’une des meilleurs écrivains français.
La déception fut cinglante.
Carole Martinez écrit pourtant merveilleusement bien : c’est de la dentelle, extrêmement construit, fluide, envoûtant et soigné, c’est une attention rare portée aux phrases. Du style, du talent, un immense talent !
« Blanche est morte en 1361 à l’âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! La vieille âme qu’elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si la petite fille qu’elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe et leurs récits alternent. L’enfance se raconte au présent et la vieillesse s’émerveille, s’étonne, se revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui l’y attend ».
Mais beau langage ne fait pas forcément bon ouvrage. La magie tangible du « Domaine des Murmures » s’est évaporée. De mon point de vue, on frôle presque l’artificiel : à coup de badine, surcot, bliaut, à croupetons, cotte-hardie, ripaille, pitance, ogre, ravauder, on sait qu’on est au Moyen-Âge ; on n’y échappera pas. À coup de chansons ou plutôt de calembredaines, bergerettes, fariboles – allons-y franchement – « Et peigne, peigne la toison. Et tourne, tourne le fuseau. Et mouille, mouille la laine du bout des doigts, et le fil se fait sans y penser ; vante l’ore et li raim crollent ; … dans le bois, joli bois – Belle, voulez-vous retourner ? Cent écus vous donnerai », l’auteur me donne la sensation de donner des coups de massue sur l’espace temporel qu’elle a choisi au point de me donner envie de demander l’asile littéraire à Voici. C’est simple, elle m’étouffe.
Pire, j’ai fermé le livre et je n’ai rien compris. Enfin, je ne crois pas. Il faudrait que je relise et j’ai la flemme ; que le temps m’a paru long sur « La terre qui penche ». Il n’y a pas qu’elle, Carole Martinez s’est trop penchée sur son roman, elle s’écoute écrire et oublie qu’un livre c’est aussi une histoire. Elle avait pourtant parfaitement réussi à joindre conte et style dans « Du domaine des murmures » : « En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire “oui” : elle veut faire respecter son voeu de s’offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe… Loin de gagner la solitude à laquelle elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour des vivants et des morts. Depuis son réduit, elle soufflera sa volonté sur le fief de son père et ce souffle l’entraînera jusqu’en Terre sainte ».
Deux siècles après, c’est l’histoire de l’émancipation de Blanche qui nous est racontée. Le parti pris était intéressant, c’est tour à tour que la petite fille, l’enfance se raconte et que la morte, la vieille âme commente ; je trouve le concept magnifique. J’ai retrouvé avec grand plaisir Bérangère, la servante dévouée du premier tome, assassinée avant de pouvoir interpeller le pape et devenue dans « La terre qui penche » l’incarnation de chair et de sang de la rivière. C’est une idée fantastique de lier la Loue et Bérangère pour prolonger la légende de la dame verte. Les loups de tissu qui prennent vie, les fantômes assassins des petites filles de rouge vêtues, Hansel et Gretel revisité, l’innocence pure d’Aymon, toutes ces énigmes à peine esquissées sont de bien jolies pistes.
C’est ça le problème de ce livre : de très bonnes idées qui s’égarent et qui au lieu d’accrocher le lecteur finissent par lui donner envie de baisser les bras. Il y en a partout, une chatte n’y retrouverait pas ses petits.
Les mystères s’accumulent et Carole Martinez prend un malin plaisir à commencer à les élucider pour brutalement laisser le lecteur sur sa faim. Sauf qu’au bout de la troisième fois, ça agace. Cela devient artificiel, on sent la manip. Le suspense est factice et le croche-pied de la fin ne rattrape rien pour la bonne et simple raison qu’à ce stade-là, on a eu tout le temps de décrocher. L’on devient indifférent. L’évocation de la relation père-fille si forte dans « Dans du domaine des Murmures » est ici avortée. Ce père violent, dur, indifférent qui au fil des récits de chacun apparaît comme un homme blessé, un jeune homme aimant n’aura pas la chance de rencontrer les mots, le cœur de sa fille. À peine lira-t-on quelques phrases sur le sujet, or je pensais que c’était un des grands enjeux de ce roman et je suis restée sur ma faim. Je m’attendais, à tort peut-être, à ce que Carole Martinez s’épanche plus sur ce sujet.
Et pour finir, on s’ennuie. On s’ennuie terriblement sur «La terre qui penche ».
Je crois que je n’ai jamais été aussi sévère dans un billet chroniquant un livre. Qui aime bien châtie bien et j’adore Carole Martinez. Ma déception est bien trop grande.
Mais qu’on ne s’y méprenne pas, elle est toujours aussi douée : « Les secrets de famille sont des fantômes, on les enterre, mais ils nous hantent. Si je doutais de mon existence, je dirais même que ce sont les seuls vrais fantômes. Mais peut-être ne suis-je qu’une simple histoire de famille qui se cherche désespérément un sens… ».
Carole Martinez est toujours aussi féministe : « car je suis BLANCHE et je serai mon domaine, mon château, ma maîtresse, nul ne me pliera plus dès que je serai grande (…) ».
Elle est toujours aussi bouleversante et la déclaration de paternité absolue qu’elle offre au futur beau-père de Blanche est à pleurer : «Être père n’est pas affaire naturelle. Je ne me souviens pas vraiment du mien, il était une grande figure absente, un mythe construit par la parole de ma mère. (…) J’ai alors choisi d’endosser le rôle de Joseph plutôt que celui de Dieu, je me suis questionné sur ce que je ressentais et non sur ce que je représentais. Tu m’as révélé à moi-même mon fils. Grâce à toi, je me suis offert la joie d’être un homme aimant et imparfait.(…) Tu es au monde, tu es le monde. Ton frère et ta sœur aînée ont été emportés par le grand mal, je n’ai pas pu les retenir. Joseph est un impuissant. L’amour et la tendresse sont impuissants ».
Carole Martinez est toujours aussi juste et pour ce paragraphe là, ce paragraphe d’utilité publique, je sauverai son livre : « Il me semble qu’une religion ne prend sens que si elle se dépouille absolument de ce pouvoir-là (temporel) et ne craint plus sa fin. Quand elle ne s’impose plus par force ou effroi, alors seulement, elle devient spirituelle et précieuse. Mais comme la majorité des hommes a besoin de croire en foule, qu’elle rêve d’un père puissant, pas d’un Joseph, et que nul n’accède au pouvoir par hasard, comme ce chemin qui y mène ne rend pas meilleur et que l’heure n’est pas au dépouillement, j’ai peur pour vous, mes chers vivants. Moi qui suis morte, je peux rire tout mon saoul des ambitieux qui se rêvent des saints en agitant l’épée du sacrifice. Je peux rire de ceux qui utilisent Dieu comme prétexte pour asseoir leur pouvoir. Mais j’ai bien peur pour vous, pauvres vivants, qu’un éclat de rire met en péril… Le rire est une menace, qui grignote les certitudes, découd les lèvres, déssille les hommes, dénude les rois, le mieux est de le déclarer hérétique ».
Alors pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
Finalement, peut-être que c’est le tome de la transition et que c’est peut-être pour ça qu’il est aussi bancal. À finir le paysage « Du domaine des Murmures » et installer les champs du prochain livre, Carole Martinez s’est peut-être perdue, elle s’est égarée, elle a perdu le cap, elle n’a pas su de mon point de vue maintenir une structure solide car prise en étau entre “le passé” et l'”avenir”. Ce n’est pas si simple de se lancer dans une trilogie, mais je lirai sans nul doute le troisième voyage des Murmures : par curiosité, par amour du style, par affection pour l’auteur.
« Tu as vécu en un siècle terrible, le pire qui fut, mais j’ai bien peur que cette nouvelle cérémonie, celle qui se prépare aujourd’hui (2015) dans cet autre siècle que je hante ne soit aussi un chant du cygne. La vierge du quinze d’août arrange ou défait tout. Cessons de jouer les Cassandre et reprenons le cours de nos souvenirs, il y a tant à raconter encore avant que nous mourions ».
- Le Bercail de Marie Causse : d'autres vies que la sienne par Thomas Messias
- Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier : tenir le chien en laisse par Anthony
- D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant par Catnatt
- Histoire de l'amour et de la haine de Charles Dantzig : rester dans sa tour par Lucile Bellan
- Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe : de quoi l’écriture se nourrit-elle ? par Alexis Joan-Grangé
- Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side par Isabelle Chelley
- Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel par Benjamin Fogel
- La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap par Catnatt
- Eva de Simon Liberati : prolonger l'obsession par Lucile Bellan
- Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène par Thomas Messias
- Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monnin (avec Alex Beaupain) : fouiller dans les photos par Lucile Bellan
- Un amour impossible de Christine Angot : nous nous sommes tant aimés ! par Arbobo
- Neverhome de Laird Hunt : l'homme qui aimait les femmes par Esther Buitekant