Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène
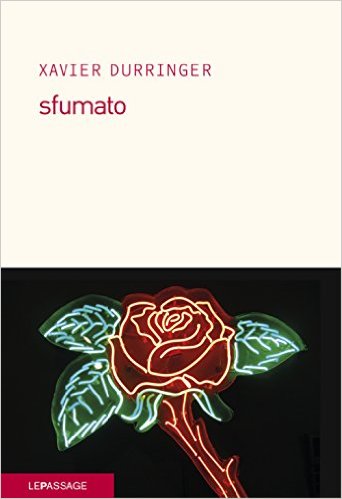
Difficile à suivre, ce Xavier Durringer. Auteur et metteur en scène de théâtre, il s’est également illustré à travers un certain nombre de téléfilms (souvent produits par Arte) ainsi que quatre longs-métrages, dont le très noir J’irai au paradis car l’enfer est ici… et le très raté La Conquête, peinture plus que grossière des années Sarkozy sortie en 2011. Pas tous réussis mais tous différents, ses films et téléfilms témoignent en tout cas d’une volonté affichée de passer d’un genre à l’autre, et surtout d’explorer tous les types de sentiments. Son premier long-métrage, La nage indienne, explorait le monde des innocents et des bienheureux. J’irai au paradis car l’enfer est ici, lui, faisait plonger ses personnages dans des abîmes d’inquiétude. Avec La Conquête, l’arrogance et l’auto-satisfaction avaient carte blanche. Sfumato, son premier roman, est un étrange condensé de tout cela. C’est même sa qualité principale : ne jamais cesser de considérer la vie comme une expérience tout sauf linéaire, pleine de facettes qui pourraient sembler inconciliables si on en avait quelque chose à foutre.
D’ailleurs, la quatrième de couverture ne ment pas sur l’incohérence assumée de l’existence de Raphaël, le héros du roman. Elle annonce d’emblée la construction en deux actes de Sfumato, à savoir une première partie en forme de petit théâtre cradingue et existentiel sur fond d’appartement pourri situé Passage de la Main d’Or, puis une seconde façon Da Vinci Code. Oui, le pavé ésotérique de Dan Brown, celui-là même qui fit le bonheur de centaines de milliers de lecteurs de plage ou de métro et amena Ron Howard à donner le pire rôle de sa carrière à Tom Hanks — ainsi que sa pire coupe de cheveux. Vers la moitié du livre, une rencontre avec le vieux Viktor, étrange type au parcours atypique et aux obsessions singulières — la spiritualité et l’étymologie, pour résumer —, l’emmène sur d’autres rives, sans pour autant lui faire quitter la Main d’Or.
Ça n’est pas là son seul but, mais Sfumato entend effectivement désarçonner en décrivant un glissement entre des situations parfaitement réalistes — quoiqu’un peu rocambolesques — et d’autres plus mystérieuses, pour ne pas dire mystiques. Mais voilà : jamais Durringer ne semble à la hauteur de ses louables ambitions. Il y a dans ce roman un problème d’écriture tout comme il y aurait un problème de mise en scène dans son adaptation cinématographique : le manque flagrant de virtuosité empêche d’adhérer à l’univers mis en place, et encore plus à la description de sa mutation. Imaginez qu’un petit cinéaste parisien pose sa caméra dans un immeuble pas très sain du onzième arrondissement, prenne le temps de filmer la réfection d’un appartement, les histoires d’amitié et de cul du personnage principal, ses problèmes de nouveau propriétaire. À quel niveau de talent faudrait-il que se trouve le cinéaste en question pour qu’on accepte, quelques minutes plus tard, de le voir étudier La Joconde comme si c’était une carte au trésor, parvenant à trouver de l’inédit dans ce tableau de Léonard de Vinci pourtant analysé jusqu’à plus soif par d’éminents spécialistes ?
L’enquête est d’autant plus pénible que Durringer n’entend pas réellement aller au bout des choses. La toute fin du roman, qui va très loin dans l’existentiel, ne fait que confirmer ce que l’on avait subodoré cent cinquante pages plus tôt : à travers cette investigation sur fond de tableaux de maître et de religion, ce n’est pas un trésor ou un secret que recherche Raphaël. Mais tout simplement lui-même. Difficile de ne pas lever les yeux au ciel à la lecture d’une conclusion si triviale.
Le roman n’avait hélas pas attendu sa seconde moitié pour être déplaisant : dès la première partie, l’écriture façon Michel Audiard du vingt-et-unième siècle avait de quoi taper sur les nerfs. Une courte citation suffira : « Simon a pété les échasses de la géante toute la nuit ». Dans le petit théâtre de Durringer, des hommes avec un cœur et des couilles rencontrent des femmes avec des seins et des culs qui finissent par les rendre malheureux après avoir joué avec eux. Par moments, la vulgarité du propos colle assez bien à celle de l’écriture. Cela n’empêche pas quelques moments assez tendres ou mélancoliques de faire mouche sur quelques pages, mais rien de plus. Lorsqu’il se tourne avec nostalgie sur la vie un peu ratée de son personnage et sur la fin d’une époque — mais quelle époque ? —, Durringer s’expose sans le vouloir à une comparaison peu avantageuse avec le Vernon Subutex de Virginie Despentes, déambulation désabusée mais extrêmement précise qui n’a nullement besoin d’une gouaille artificielle et de mauvais goût pour parler à son lectorat.
- Le Bercail de Marie Causse : d'autres vies que la sienne par Thomas Messias
- Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier : tenir le chien en laisse par Anthony
- D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant par Catnatt
- Histoire de l'amour et de la haine de Charles Dantzig : rester dans sa tour par Lucile Bellan
- Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe : de quoi l’écriture se nourrit-elle ? par Alexis Joan-Grangé
- Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side par Isabelle Chelley
- Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel par Benjamin Fogel
- La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap par Catnatt
- Eva de Simon Liberati : prolonger l'obsession par Lucile Bellan
- Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène par Thomas Messias
- Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monnin (avec Alex Beaupain) : fouiller dans les photos par Lucile Bellan
- Un amour impossible de Christine Angot : nous nous sommes tant aimés ! par Arbobo
- Neverhome de Laird Hunt : l'homme qui aimait les femmes par Esther Buitekant