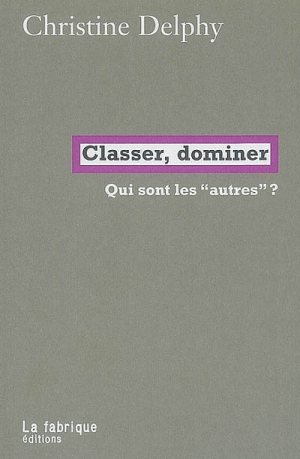Pourquoi penser le racisme en France avec une philosophe féministe ? Aujourd’hui, alors que la « cause des femmes » et la « laïcité » sont instrumentalisées par des personnes qu’on n’aurait jamais soupçonnées de posséder de telles convictions profondes, mais qui brandissent désormais nos valeurs dans un miroir si déformant qu’il devient pénible d’utiliser les mêmes termes qu’eux, il semble important de faire circuler des analyses et des concepts d’une lutte à une autre. Pour éviter la mise en concurrence des causes, pour éviter de reproduire selon d’autres grilles les mêmes réflexes de mépris et de domination.
Christine Delphy sait d’où elle parle : de décennies de réflexions et de militantisme contre la domination d’une moitié de la population par une autre, à savoir les hommes sur les femmes. Après avoir suivi de près le mouvement des droits civiques des Noirs aux États-Unis, elle devient féministe dès les années 1960, époque où la société française s’organise autour de « chefs de famille » qui ont le contrôle sur la production domestique de leur épouse, où les femmes sont interdites d’accès à certaines grandes écoles et institutions du pays, où elles n’ont pas le droit de disposer librement de leur corps – être femme est une spécificité un peu honteuse, une forme de handicap à vie.
Cette longue expérience lui a permis d’acquérir toute une gamme d’outils de pensée efficaces pour comprendre les mécanismes qui consistent à créer ou renforcer une catégorie de la population comme distincte d’une autre pour, en même temps, la déclarer inférieure. C’est une féminisme matérialiste, c’est-à-dire qu’elle s’intéresse à l’ensemble des conditions concrètes d’oppression qui font système et produisent des dominés et des dominants : une société donnée produit, de façon structurelle, les femmes en tant que femmes, avec leurs caractéristiques stéréotypées, les homos en tant qu’homo, les musulmans en tant que musulmans.
Cette conception s’oppose, entre autres, à une vision individuelle, morale ou psychologisante du sexisme, de l’homophobie ou du racisme, selon laquelle il faudrait simplement être tolérant ou respectueux. Un homme pourrait ainsi se défendre d’un discours féministe en arguant « mais enfin, je n’ai jamais violé personne », alors que ce qui est dénoncé, c’est l’ensemble de structures sociales et institutionnelles, de discours ambiants, de modèles et de détails parfois infimes qui tendent à justifier ou même valoriser l’agression sexuelle ; ce qu’on appelle la culture du viol.
Delphy est une figure importante du féminisme actuel, qui, entre autres, apporte son soutien aux femmes voilées et prône la pénalisation des clients de prostituées. Sa pensée s’est construite en réponse au contexte politique de notre pays et aux impacts de l’actualité internationale dans le débat public, mais elle a également su se nourrir des concepts forgés, par exemple, par les afro-féministes américaines.
Ainsi, en la lisant, je pense depuis le féminisme, qui me touche viscéralement de par mon expérience et l’empathie spontanée que j’ai vis-à-vis des oppressions des femmes. Et, parmi ces outils qui m’aident à penser, il y en a qui m’intéressent particulièrement quand il s’agit de les déplacer dans d’autres contextes de lutte.
- Le point de vue situé (standpoint) est la prise en compte d’un biais dans notre rapport au réel : c’est-à-dire que, pour moi, l’islamophobie n’existe pas vraiment, je peux éteindre la télé, ignorer certains discours et tout simplement l’oublier, car je n’en fais pas l’expérience physique, par de petites vexations, au quotidien (comme je peux faire par exemple l’expérience du sexisme en marchant seule en jupe la nuit). On ne mesure pas de la même façon l’antisémitisme en France si on se promène avec une kippa – et je ne parle même pas de chercher un appartement en se prénommant Mustapha.
- « Ne me libère pas je m’en charge. » Cette phrase clé du féminisme formule le fait que les victimes d’une oppression sont ceux qui sont les plus à même de mener un combat pour la dénoncer. Elle montre un refus du paternalisme de ceux qui comprennent, qui sont d’accord, mais qui, tout en se trouvant du côté des privilégiés (ou peut-être justement pour cette raison), considèrent qu’ils ont des mots plus juste pour le dire, et de meilleures solutions. Au regard de cela, « Touche pas à mon pote » est, d’un point de vue énonciatif, l’exact opposé ; la formule d’SOS racisme suffit à elle seule à résumer tout le malaise qui a accompagné l’histoire de cette organisation : il s’agit bien d’un homme blanc qui parle, à un autre homme blanc, encore une fois.
- La réappropriation du stigmate, ou ce moment où ce que l’on considère, au sein d’une société, comme un signe d’infériorité, voir une insulte, finit par être brandi par ces mêmes « inférieurs » comme une fierté, une revendication d’appartenance à une communauté spécifique. On connaît le processus pour les homosexuels qui finissent par se revendiquer queer, les Noirs qui finissent par vanter leur négritude et porter des coupes afros. Dès lors, comment s’étonner que, dans un contexte de racisme post-colonial qui a fini par faire porter à la religion musulmane la responsabilité d’une soi-disant arriération culturelle, certaines femmes revendiquent fièrement le port du voile ?
- Le pouvoir-savoir, c’est le droit à la parole, le droit de définir les « nous » et les autres, de tracer la frontière, d’énoncer les conditions d’entrée dans le club des « nous ». En tant que dominant, personne ne peut me nommer, me définir. D’où mon étonnement quand j’ai découvert, à 20 ans, que j’étais par exemple straight – à bon, il y a un nom pour ça ? Eh bien oui.
- L’universalisme. On sait grâce à la grammaire que le masculin, c’est neutre ; la femme, c’est le spécifique. C’est ainsi qu’il existe un schtroumpf grincheux, feignant, rêveur… et une schtroumpfette (signe distinctif : femme). On sait aussi grâce au langage politiquement correct que le Français normal est un Français « de souche » (ce qui englobe bien sûr les souches italiennes, polonaises ou portugaises). Les autres sont « issus de l’immigration » (ce pays qui n’est sur aucune carte), mais depuis dix ans on entend plus souvent parler de musulmans, la faute au contexte international depuis le 11-Septembre. C’est bien pratique : si on critique les Arabes, on est raciste (bouh) mais si on critique les musulmans, on est laïque (bravo). En prétendant incarner l’universel, les « nous » nient le classement auquel ils procèdent. Ils peuvent ainsi demander aux « autres » de s’adapter (même s’ils ne feront jamais partie du club) ou alors de rester discrets. Toute démarche pour contrer l’isolement et la honte (puisqu’être homo, arabe ou femme constituerait des catégories moins universelles) est donc du communautarisme. « Les Uns sont ceux qui ont la droit de fermer leur porte à qui ils veulent, de rester entre eux, mais qui exigent de pénétrer partout, et de s’y sentir à l’aise. »
- Les prophéties auto-réalisantes. Parfois les stéréotypes sur les dominés finissent par devenir en partie vrais, à force d’incertitude sur le sens des interactions (les « nous » ont le monopole de l’interprétation), à force de vouloir se plier aux normes établies pour « s’intégrer », à force d’humiliation quand ça ne passe pas, à force de prendre le contrepied pour réaffirmer sa spécificité. « L’altérisation produit donc une altération des personnalités des dominé-e-s. » Ainsi, traitez toute une partie de la population comme des terroristes en puissance pendant des années, et il y en aura bien quelques-uns pour finir par se laisser convaincre.
Ce qui me touche dans « Classer, dominer », c’est donc le moment de sa réflexion où, après avoir documenté, conceptualisé et quadrillé les formes de la domination masculine, elle fait le lien entre le combat féministe et d’autres. Bien sûr ces parallélismes ont leurs limites, et il ne s’agit pas de nier la spécificité de chaque forme de domination. Mais elle a le mérite d’aborder de front le problème presque insoluble de l’articulation des oppressions.
À une époque, on demandait aux féministes du MLF s’il n’était pas plus urgent de lutter contre le capitalisme que contre le patriarcat ; ou aux afro-féministes s’il n’était pas plus urgent de lutter contre la ségrégation raciale. Aujourd’hui, il semble que la question se soit inversée et que l’on demande à tous : n’est-il pas plus urgent de lutter pour les droits des femmes – certains droits bien précis – que contre le racisme ou la pauvreté ? C’est ainsi que l’on passe une série de lois contre le voile en stigmatisant tout une partie de la population française, mais aussi que l’on part faire la guerre en Afghanistan (les femmes afghanes vous disent bien merci).
Pourtant, la convergence des luttes n’a rien d’intuitif. Imaginons une association LGBT manifestant aux côtés de musulmanes pratiquantes pour le mariage pour tous et le droit de garder le voile à l’université ; ou encore un collectif de jeunes étudiantes contre le harcèlement de rue se solidarisant avec des ouvriers du bâtiment qui demandent une revalorisation de leur prime de précarité. On sent bien que ça ne colle pas.
Paradoxalement, on dirait que la seule façon de pouvoir articuler toutes les oppressions est de n’en subir aucune – ou de les subir toutes ? Sinon, le plus souvent, on ressent malgré tout que la priorité se situera là où nous faisons l’expérience directe, personnelle, d’une inégalité. Mais alors, comment se positionner si on est à une « intersection », si l’on est, par exemple, arabe et gay ? Ou si l’on est une femme migrante, ayant subi comme c’est fréquent des agressions sexuelles – de la part d’autres migrants ou de policiers.
Et puis les identités politiques sont complexes, et qui plus est mouvantes en fonction des thèmes qui prédominent dans le débat public. Est-ce que ma place dans la société se définit plutôt par mon appartenance à un genre, une classe sociale, une orientation sexuelle, une religion, une zone géographique ? Et à moins d’être pauvre, femme, noire et homosexuelle à la campagne, on est toujours le dominant de quelqu’un d’autre, d’où un inconfort certain à discuter de ces questions. Mais ces outils que nous propose Delphy sont là, parmi d’autres, pour nous aider à penser un inconfort fertile, qui ne paralyse pas le discours mais au contraire donne à penser.