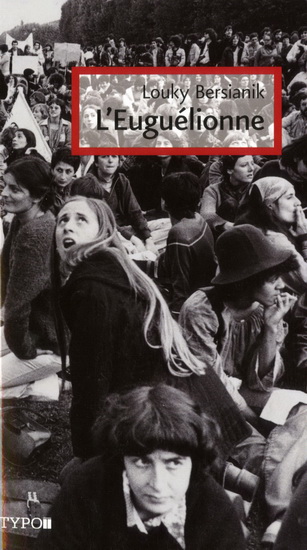Ce livre, paru en 1976, est un ovni : on l’appelle roman, mais on y trouve des allégories échevelées, on y disserte sur la femme au foyer et le machisme de la langue française, on y suit les aventures de personnage loufoques qui traversent des marais à la recherche de leur nom, puis la narration s’arrête le temps d’un poème ou d’une comptine ironique.
Livre-somme, livre-manifeste aux ambitions démesurées et aux intonations prophétiques, L’Euguélionne me fait l’effet d’un Ainsi parlait Zarathoustra féministe. Écrit par Louky Bersianik, auteure québécoise, il est longtemps resté comme un secret bien gardé, une bible qui se transmet de militante en militante (jusqu’à avoir été choisi comme nom par une librairie féministe à Montréal).
Dans ce roman-essai-pastiche, il s’agit de réinventer des formes et des imaginaires, de pointer du doigts les ressorts du patriarcat avec verve, inventivité et humour. Et comme nulle n’est prophète sur sa planète, Bersianik nous raconte l’arrivée en fanfare de l’Eugélionne, prophétesse débarquée un beau matin sur Terre.
« – Ce que je veux, dit l’Euguélionne ? TOUT ! JE VEUX TOUT !
[…] Elle était ensevelie sous un nombre incalculable d’ordres péremptoires reçus depuis sa naissance, qui lui faisaient des couches successives de linceuls impénétrables dont, ressuscitée d’entre les morts, elle voulait se débarrasser. Sans jamais avoir choisi les situations qui lui valaient des commandements aussi strictes, elle s’était vue, tout le long de sa vie, condamnée à obéir ou à transgresser. »
On traversera en ces pages un panorama de l’humanité genrée à travers tout l’attirail des textes sacrés : cosmogonies, généalogies, prophéties. Ainsi se superposent plusieurs récits de l’apparition de l’homme et de la femme, leur assignation à un genre, la répartition des rôles, les prises de pouvoir et les révoltes de différentes engeances sur différentes planètes. Le tout entrecoupé de récits prosaïques de vie quotidienne, vies de couple, de mères, d’épouses. Mariage, tâches ménagères, harcèlement, avortement, viol, toute la lignée des combats et révoltes des femmes au prisme d’un regard extraterrestre.
Composite, livre-gigogne dans lequel chaque histoire donne naissance à une autre histoire, il met en application dans le champ littéraire une des maxime que l’on retrouve en exergue : « Transgresser, c’est progresser. » L’écriture permet de parodier les discours misogynes (publicitaires, littéraires, religieux) et de dénoncer les pratiques sexistes, le tout avec une ironie féroce. Ainsi les paraboles pullulent, de verset en verset : la femmes enceinte est une maison hantée, le mariage un cercle magique à l’entrée duquel on perd son nom. Les défilés de chariot sortant du ventre des femmes transportent la chair à canon, à usines, à cuisines, la chair de prison et la chair de consommation. « Vous serez des adjectifs, dit-on aux pédaleuses dans leur berceau. Et aux législateurs : vous serez des verbes. » Le sexisme de la langue française, par exemple, y est dénoncé à travers des listes proliférantes de féminisations délirantes qui feraient se retourner dans leur Académie des générations de grammairiens. On y trouve de tout, à boire et à manger, des choses à prendre et des choses à laisser, des questions très datées et d’autres d’une actualité remarquable.
L’Eugélionne raconte : « J’ai observé un jour Elsie, Lacie et Tillie, les trois sœurs qui vivaient au fond d’un puits de mélasse. Elles souffraient de malnutrition, de diabète, de claustrophobie et de toutes sortes de malaises engendrés par leur misérable condition.
Et pourtant, chacune d’elles s’efforçait de dépasser cette condition, car elles s’étaient mises à dessiner. Mais comme la seule chose qu’elles voyaient à cœur de jour, la seule chose dont elles connaissaient le goût, la texture et la couleur, c’était de la mélasse et uniquement de la mélasse, eh bien, elles dessinaient de la mélasse. Elles ne connaissaient rien d’autre, les trois petites sœurs, car elles vivaient réellement dans un puits de mélasse.
Chaque matin, les Législateurs venaient sur la margelle du puits jeter un coup d’œil sur leurs dessins pour voir si elles faisaient du progrès. Hélas, il y avait toujours de la mélasse sur ceux-ci et les Législateurs s’esclaffaient en disant :
« Elles n’ont vraiment aucun talent ! Regardez-les ! Ne sont-elles pas ridicules ? Elles veulent nous imiter et faire des chefs-d’œuvres et tout ce qu’elles trouvent à faire, c’est dessiner de la mélasse ! Et qu’est-ce que la mélasse ? Cela n’a aucune forme ni aucun sens ! Nous n’avons jamais rien vu d’aussi grotesque ! Elles auront beau faire, elles n’arriveront jamais à fair des chefs-d’œuvre, jamais elles n’arriveront à nous égaler ! »
Et ils s’en allaient en sifflant, un sourire méprisant aux lèvres, les mains dans les poches, à l’air libre ! »
Le foisonnement de ces pages nous replonge dans une époque, celle des grands combats féministes des années 1970, qui va avec son folklore et sa littérature « condamnée à transgresser », justement – avec tout ce que cela comporte de fantaisie et de lourdeur. C’est donc un livre attachant, parce qu’il est plein de défauts : il peut parfois être un peu didactique, désuet, mais au milieu de tout ça on tombe sur des perles incroyables, des trouvailles verbales et une irrévérance décapante. On se fait souvent la réflexion que le féminisme manque de mémoire historique, que ses débats et ses productions sombrent trop souvent dans l’oubli, vouant le mouvement à un éternel recommencement. Il faudrait relire L’Euguélionne comme on trace un trait d’union.