La Vengeance m’appartient de Marie NDiaye : à tue et à toi
Paru le 7 janvier 2021 aux éditions Gallimard.
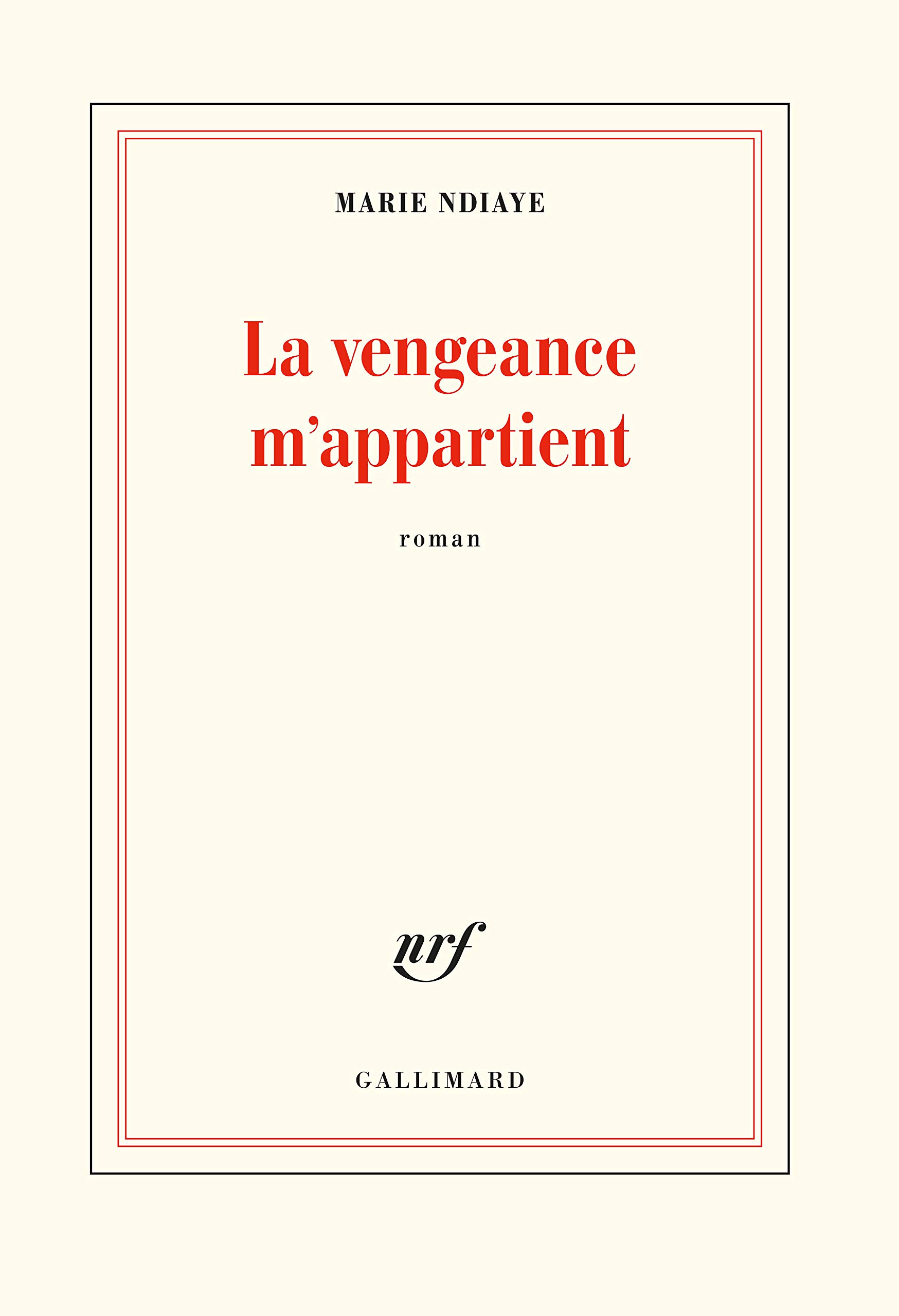
À égale distance de l’étrange et du frontal, Marie NDiaye occupe dans les lettres françaises une place à part. Publiée dès ses dix-sept ans aux prestigieuses éditions de Minuit, elle creuse un sillon qui semble pourtant la précéder. Le 10 novembre dernier, le Théâtre de la Ville retransmettait en direct la représentation sans public de son monologue titré Royan, la professeure de français, interprété par Nicole Garcia seule en scène. Seule en scène : l’expression n’avait jamais été aussi appropriée, pour un texte qui parvient à saisir l’époque tant par sa forme que par son fond : la torpeur abyssale d’une enseignante aux abords du drame.
Dans La Vengeance m’appartient paru moins de deux mois plus tard, sous un titre aussi programmatique qu’irrésolu, Marie NDiaye développe plus que jamais son écriture du trouble et sa syntaxe du ressac, pour suivre une ligne ténue entre le dérangeant et l’envoûtant. On retrouve la ville de Bordeaux et ses environs, où se situait l’action de Mon cœur à l’étroit, le premier roman qu’elle avait publié chez Gallimard – le suivant étant appelé à recevoir le prix Goncourt. En 2007, la capitale girondine était envahie par le brouillard, quatorze ans plus tard elle est prise dans la glace. Les éléments, à eux seuls, viennent déjà évoquer une vengeance possible. Mais contre qui, contre quoi ?
H… Susane est le personnage principal de ce texte, dont on ne connaît que l’initiale du prénom mais que la narration du roman désigne par l’attribut de son métier d’avocate : Me Susane, donc. Grande et laide, peu décrite par ailleurs, elle est âgée de quarante-deux ans et se trouve depuis peu à la tête de son propre cabinet. Elle est restée en très bons termes avec Rudy, un ancien collègue avec lequel elle a vécu plusieurs années, au point d’être une sorte de seconde mère pour Lila, fille née du mariage avec une autre femme, rencontrée après la fin de leur relation. Me Susane a peu d’affaires à traiter pour le moment et son esprit est assez occupé par ses rapports avec Sharon, femme de ménage d’origine mauricienne, pour qui elle tente d’obtenir des papiers en règle à titre gracieux et qu’elle emploie sans vraiment avoir besoin de ses services. Sharon s’avèrera vite par ailleurs une nounou hors pair, quoique ponctuelle, pour la jeune Lila. Une nounou en tous points supérieure au couple de M. et Mme Susane, démonstratifs et peu scrupuleux.
Me Susane rend fréquemment visite à ses parents modestes, dans la campagne bordelaise de La Réole (où habite de fait Marie NDiaye) et se souvient avec acuité d’une matinée de ses dix ans, un jour durant lequel sa mère effectuait du repassage en remplacement d’une autre dame, chez un couple du quartier bourgeois de Caudéran. Ce couple avait un fils âgé de quatorze ans, très distingué, dont l’invitation à visiter sa chambre aura marqué Me Susane à jamais. Mais ce qui s’est passé, exactement, dans cette chambre, reste perdu dans les limbes du souvenir, de même que le nom de la famille en question. Était-ce Majuraux, Ravalet, Robineau ?
Ou Principaux, comme ce Gilles Principaux qui dès l’entame du roman se présente dans le bureau de Me Susane et cause chez elle un choc profond. Elle est presque sûre de le reconnaître, sans pouvoir établir avec certitude le lien avec la scène de Caudéran. Le désarroi de l’avocate est loin d’être atténué par les circonstances dans lesquelles Principaux vient la voir, puisque sa démarche vise à confier à Me Susane la défense de sa femme Marlyne, accusée du triple meurtre de leurs jeunes enfants, crime atroce qu’elle reconnaît totalement.
Épouse modèle, disaient pourtant certains. Pas sa famille, qui la trouvait trop soumise à un époux lui déconseillant de poursuivre son travail d’enseignante de français (Royan est ainsi proche de Bordeaux). Épouse martyre et sacrificielle, qui en donnant la mort pose un geste, comme elle le dit elle-même, sans l’expliquer autrement que par l’impossibilité de faire autrement. C’est au cours d’une longue confession au parloir de la prison qu’on l’apprend, monologue lardé du mot «mais» qui agit comme un mantra, comme la clé vers le territoire lointain d’une circonstance atténuante. En miroir, Gilles Principaux bardera son propos incontrôlable d’une autre conjonction de coordination, «car», tic verbal soulignant sa propension à faire valoir son bon droit.
Tout au long du livre, une litanie de passages en italiques et de formules interrogatives vient perturber le cours du récit et le raisonnement douloureux de Me Susane, sans cesse ballottée entre un passé sujet à caution et un présent explosif. De même que Rudy, elle a fui sa classe d’origine grâce à de brillantes études. Mais ses parents semblent lui en vouloir. En tout cas, ils lui reprochent d’accorder à l’épisode de Caudéran une trop grande importance, ou plus précisément une importance positive alors qu’ils la trouvent néfaste. Est-ce la raison pour laquelle Me Susane investit totalement la cause de Sharon, ayant fui l’île Maurice pour une meilleure condition au risque d’une brouille définitive avec son frère adoré ? Le point nodal semble être les souvenirs, ce qui nous a fait, la d’où on vient. S’extraire de sa condition peut-il se jouer à pile ou face, la pièce étant la mémoire ?
Le passé négrier de Bordeaux joue un rôle dans le récit, comme si la ville était un personnage. Un client de Me Susane souhaite ainsi à cor et à cri changer de patronyme, persuadé sans preuves que le sien est lié au sinistre commerce de l’esclavage dont le port bordelais était une plaque tournante. La ville se venge-t-elle de son passé à travers la figure de Sharon, qu’emploie également la vieille mère de Gilles Principaux, jadis employeuse de Mme Susane ? Le riche professeur Gilles Principaux doit-il s’incliner en demandant la défense de Me Susane ? Pour se faire pardonner quel méfait ? Une vie domestique aliénante a-t-elle armé le bras de Marlyne, lui ôtant tout discernement moral ?
La science du mystère est au principe de la prose ndiayienne, comme l’est sa science du lieu. Le Bordeaux onirique qu’elle décrit est des plus entêtants, de même qu’est effrayante la vision de la maison rangée à l’extrême et sans âme de la mère infanticide. Le parloir de la prison, véritable pivot du livre, est par définition un non-lieu – sans mauvais jeu de mots –, mais les mots de Marie NDiaye parviennent néanmoins à l’habiter et à lui donner vie. La romancière déclare que le rêve d’une scène est au principe de chacun de ses romans. Ici c’est la scène d’incipit, pour un livre clos par une plaidoirie sonnant comme un songe et qui décrit un endroit honni, le foyer familial des Principaux : jusqu’à quel point peut-on se tromper sur un nom, sur une vie, sur sa propre vie ?