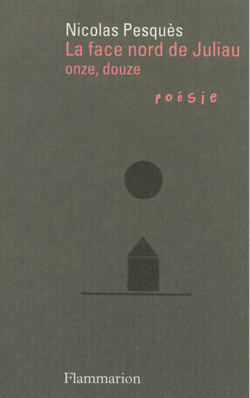La poésie n’est pas photogénique. Mis à part des vers qui fleurissent dans le métro au printemps, vite lus vite oubliés, qui doivent frapper par leur évidence comme des slogans publicitaires, la poésie demande du silence, du temps pour ruminer une langue. Elle agit souvent mine de rien, comme une taupe, creusant obstinément les fondations sur lesquelles reposent notre perception du monde et notre langage quotidien. Rien de spectaculaire.
Et puis la poésie contemporaine est prise entre deux feux : de bien maigres moyens (plus de rimes, d’alexandrins, bien peu de musique) mais des attentes démesurées ; parce qu’on attend encore du poète qu’il change la vie, qu’il soit l’élite de l’élite de la littérature, le génie, le sauveur de la langue française et de la beauté de ce monde.
On cherche des héros, des figures de proue, des mouvements, alors que s’il y a bien une chose que l’on peut dire de notre époque, c’est qu’elle est celle de l’émiettement des productions culturelles, de leur prolifération, des immenses étalages entre lesquels on erre, l’oeil hagard, sans toujours savoir vers qui se tourner. C’est presque une blague que tous les lecteurs de poésie sont des poètes aujourd’hui, comme s’il fallait être initié pour rentrer dans le saint des saints, oser ne pas comprendre, faire l’effort sans avoir peur qu’on se foute de nous, franchement, ces trois mots côte à côte qui ne veulent rien dire, mon petit frère aurait pu faire ça, etc.
Dans ce grand marché bordélique, rien de tel que quelques maisons d’édition en qui l’on a confiance pour découvrir de nouveaux auteurs. À l’occasion des 20 ans de la collection Flammarion poésie dans sa forme actuelle, j’ai donc voulu revenir sur 3 poètes que j’ai découverts dernièrement et qui m’ont marquée, trois voix que je lis et relis pour la précision des mots, l’inconfort du souffle, le moment où le coup porte.
* Cécile Mainardi *
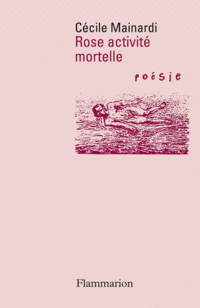
Les textes que j’aime de cette auteure sont ceux du désir en roue libre, monstrueux désir démesuré qui déclenche des flots de paroles obsessionnelles, comme dans La Blondeur, publié aux petits matins, ou Rose activité mortelle, dernière suite de son recueil chez Flammarion. Poésie de persistance rétinienne, qui tourne autour d’un objet aimé, les mains devant, le corps et la voix en déséquilibre . Comme sur une plage après la marée, elle bute sur chaque reste, chaque trace, d’où elle rétablit des courants interminables.
L’être aimé se décuple, il a plusieurs têtes, des mains partout, des corps humains et animaux, et dans sa folle explosion de sensualité, le langage déborde pour atteindre le creux des reins.
Ça donne ça:
« Je te rejoins donc là, remonte à ta surface
t’atteins par paliers successifs,
conformément à ce que je déforme en toi
d’axe au ralenti et en devenir, tu dis non
du regard, tu m’encaisses et j’ai
du mal à t’encaisser. Plus qu’une simple désunion
à ton ombre, tu glisses autre chose
que ta langue dans autre chose que ma
bouche, désenclenche d’intarissables récits
de mort et de combats, fais s’abreuver
le reflet d’animaux dans le corps d’animaux
réels, laisses vide la place de leur nom
accoles leurs lèvres au double monde et
fais qu’il relèvent sensuellement
la tête en direction d’un univers plus vaste
qu’avant d’y avoir bu, désassemble
le sens des mots j’en profite pour te
dire que je ne te vois plus ou continue
avec ta main, histoire de commenter la ruine exacte
qui les gagne, l’erreur qui les contamine
(…) tu tends, tu
augmentes en masse et en désir, me retournes
sur le ventre et je serai de toi l’ombre
de toi portée »
Elle a cette façon de se dévouer à la passion, à un motif auquel elle s’accroche avec ferveur pour le démultiplier. Entre volonté et relâchement, elle se laisse emporter en se jetant dedans la tête la première. Et c’est beau.
* Guy Viarre *
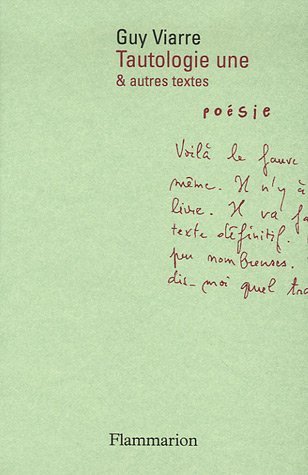
En découvrant Guy Viarre je me suis pris une grande claque. Avec ses lignes qui foncent dans le mur, ses images qui renversent tout ce qui semblait établi dans le langage, on sent chez lui une intransigeance radicale, une quête — vouée à l’échec — qui ne se satisfait d’aucun faux-semblant. Le trait de la phrase ne débouche sur rien, ses vers aiguisés repoussent difficilement le silence, et y retombent très vite. Il n’y a pas d’évasion possible, pas de nature, de coucher de soleil. Juste des corps pris dans la matière.
« car tel parle le pays démembré
aux arbres déchirés
réunis fermés sur leur oeil »
Le réel tire sur la laisse. Il ne reste que quelques mètres carrés de langage dans lesquels tourner. À défaut de les élargir on creuse, et comme il creuse ! Il ronge à l’os ce qu’il y a de saveur dans les mots, pour n’y laisser qu’un goût métallique, un trait de craie sur tableau noir.
« entendre la bête se taire et se pendre, d’abord se taire et puis se pendre avec les aboiements qui ont fondu »
Sa langue s’appuie sur un réel « qu’elle braque d’un vers en canon scié, qu’elle pilonne en kamikaze exténué, sans relâche, d’un ressassement perdu d’avance mais qui ne prend pas fin » (Cédric Démangeot). Il n’y a pas d’évasion possible. Les mots pourraient bien rater leur coup, rater le réel malgré le braquage radical qu’ils tentent, le tout pour le tout. Avant de revirer au noir, toujours déjà présent.
Le couteau sous la gorge, le souffle court, on lit encore, pour tenter de le suivre
« tout afin de toucher d’être touché renversé
entubé brûlé une saison sèche le foin rentré
du regard »
* Nicolas Pesquès *
Il n’y a rien de clinquant, de coup-de-poing dans ces lignes qui forment les parties onze et douze du projet La face nord de Juliau. Mais cette poésie de « bas voltage » répond à une démarche fascinante dans son obstination tranquille : écrire jour après jour, année après année, sur la même face nord d’une colline ardéchoise. Écrire la façon dont on peut être retenu par un paysage familier qui reste malgré tout étranger, inaccessible.
Face à cette pauvreté du motif répété sans cesse, cette démarche a tout d’une ascèse. Elle atteint son degré extrême de dépouillement dans la partie onze, d’où même la couleur est absente.
« Ici, si noir est ce mat d’où n’émerge qu’une parole, on se demande quelle colline est possible. Un corps qui ne sait quoi faire ni où aller. Noir sur le point de se dissoudre dans une seule image-mère. Mer d’images.
Brasse de phrase sous la visibilité. Corps atteignant son socle. À genoux et sans religion. »
Ce constat de la séparation d’avec le paysage met à jour ce qu’il y a d’inhumain dans la nature, mais aussi ce qu’il y a d’inhumain dans l’homme : cette part du réel que les mots ne saisissent jamais et qui nous échappe, dont on ne peut pas faire l’expérience.
Et ces écrits pour le moins austères sont interrompus en leur milieu par deux documents, notes intimes de l’auteur sur sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. À sa question répétée « si je te dis le mont Juliau, qu’est-ce que ça t’évoque ? » les réponses de la mère se délitent de semaine en semaine. En perdant la mémoire, elle perd le monde, et il ne reste qu’un langage en roue libre. Notées fidèlement, ces réactions portent un témoignage fidèle et pudique d’une fin de vie qui se déroula elle aussi avec cette colline, sempiternellement, comme point de mire.
Ces quelques notes synthétisent la démarche du poète : poser toujours la même question face à quelque chose qui nous échappe, et recueillir l’infinie variation de réponses que le paysage, ou une mère malade, peut faire. Des réponses qui s’appauvrissent ou s’enrichissent d’une manière inattendue, dans un reflet sur l’herbe, dans une phrase qui dévisse.
« Faire mal : est-ce dire ou mal dire ? Les baies noires sur la langue. Le râteau sans cicatrice. Bloc à trois, fondu sans inscription. La huppe enlevée, la plainte enlevée et la souffrance en colline. Ce bel ensemble bêché. Bel été. Tous ces pansements. »