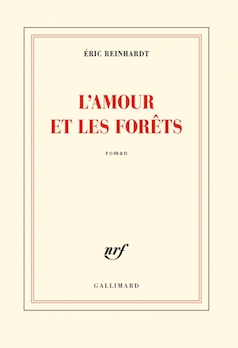D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant
Paru le 26 août 2015. 484 pages. Éditions Lattes
« Toute écriture de soi est un roman ».
Acheté un jour, terminé le lendemain, « D’après une histoire vraie » est un roman qui ne vous lâche pas : semi policier, il parle essentiellement de littérature, accessoirement de manipulation. Une Delphine de Vigan post « Rien ne s’oppose à la nuit », en pleine crise de la page blanche, rencontre L. dont elle ne pourra bientôt plus se passer, béquille apparemment bienveillante de ses errances. L., une majuscule et un point, l’un pour signaler sa présence envahissante, l’autre pour indiquer que nous ne saurons jamais qui elle était vraiment. Un livre qui parle aussi de l’après, que fait-on lorsque l’on a publié un roman sur sa mère qui a rencontré le cœur de dizaines de milliers de personnes ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Est-on condamné à creuser les sillons de sa propre histoire ? Vraie ? Peut-on retourner à la fiction pure ? Delphine de Vigan a été maligne, elle a publié le roman d’une possible transition, entre réel et fiction, on ne le saura pas et ça n’a aucune importance. Elle a créé le point d’interrogation ; le point d’interrogation après l’exclamation de la vie de Lucile, sa mère, le point d’interrogation sous une forme contradictoire : une majuscule et un point, ce qui commence une phrase et la termine, le début et la fin sans qu’un milieu réel apparaisse.
La quête du vrai ou plutôt les questions infinies qu’elle suppose est présente tout le long du livre, évoquées dans de longues conversations ou des monologues effrayants tout en racontant une histoire dont on ne sait si elle est réellement arrivée. Une mise en abîme : « Même si cela a eu lieu, même si quelque chose s’est passé qui ressemble à cela, même si les faits sont avérés, c’est toujours une histoire qu’on se raconte. On se la raconte » . Delphine de Vigan n’a pas de fulgurance littéraire, de phrases qui vous attrapent et suspendent la vie, ces quelques secondes d’arrêt sur des mots où tu te dis que ceux-là assemblés sont beaux à tomber, des lettres qui suspendent le temps et mettent un terme à cette quête qui consiste à chercher à parfaitement définir un moment, une émotion, le monde, la vie. Non, elle écrit intensément vivant. Vous ouvrez le livre et une Delphine de Vigan, la vôtre, s’assoie près de vous et vous raconte une histoire. On est ensemble. De l’anecdote la plus inutile à l’action déterminante, elle construit une parenthèse où vous faites corps. Elle ne se planque pas, vous connaissez presque le déroulement de l’histoire à l’avance, la chronique annoncée du drame, vous savez qu’entre cette Delphine et L. ça va mal se terminer. « Misery » de Stephen King est là en filigrane. Elle sème sciemment des indices qui vous donnent un temps d’avance sur la chronologie sans que vous vous rendiez compte que vous prenez un temps de retard sur les émotions qui accompagnent le dénouement. Et c’est là où se situe le fragile équilibre qui fait de ce livre, un bon livre malgré une histoire maintes fois traitée par d’autres.
Il s’est passé quelque chose de très curieux lorsque j’ai lu ce roman, je n’ai pas pu m’empêcher de penser sans arrêt à « L’amour et les forêts » d’Eric Reinhardt que j’avais traité pour la rentrée littéraire de l’année dernière. Je me disais sans cesse que quelque part justice avait été rendue. Le raisonnement est hasardeux, je le sais. Que l’on se souvienne, ce livre parlait des pervers narcissiques et de la rencontre entre un Eric Reinhardt de « fiction » et une certaine Bénédicte Ombredanne :
« À l’origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l’écrivain, l’entraînant dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte ».
L’auteur en avait fait un livre en sus d’évoquer et d’interroger la littérature. Pourtant, tout était supposé fiction ou quasi. Quelques mois après, l’héroïne du livre prenait vie affirmant dans les journaux que Reinhardt lui avait RÉELLEMENT piqué sa vie créant des dommages collatéraux terribles puisqu’il avait déformé les choses. On ne sait ce qu’il est advenu. J’ai beau regarder l’onglet actualités associé au nom, tout s’arrête en mars 2015. Je ne sais si Delphine de Vigan y a pensé, en tout cas, moi ce fut le cas : contrairement à “L’amour et les forêts” ce n’est plus l’écrivain qui manipule la lectrice, c’est l’inversion des rôles, la lectrice manipule l’écrivain, toujours la perversion narcissique en toile de fond et cette éternelle question : « Qu’est-ce que la littérature ? ». Pour moi, elle a, réel ou fiction, rendu justice aux lecteurs, à tous ceux et celles qui se sont retrouvés dans des romans et qui n’en demandaient pas tant, cette guerre invisible, les victimes de la littérature : « Je croyais l’avoir trahie, mais c’est exactement ce qu’elle avait voulu. Devenir mon sujet. Et m’amener ainsi, malgré moi, à plagier les auteurs que j’aimais ». Bénédicte Ombredanne, une fiction posée sur l’autel de la rentrée littéraire 2014 est vivante et blessée ; L. dont on ne sait rien, possible double fictif de Delphine De Vigan, posé sur celui de l’année suivante lui donnant en quelque sorte sa revanche.
Quelle ironie !
Le plus dérangeant pour moi, l’inconfort tangible, c’était de retrouver tant de points communs entre L. et moi. J’ai la lecture narcissique, que voulez-vous… Cette empathie, cette aptitude à rentrer en collision avec les attitudes détestables d’autrui, cette sale manie de faire parler les autres, genre d’interrogatoire, les mêmes questions, « peut-on porter une mini-jupe à quarante ans ? », cette manière de pousser l’autre dans ses retranchements, les changements d’humeur. J’aurais pu être L. si je m’étais laissée aller à la toxicité ; j’ai la faiblesse de croire que la bienveillance est mon socle. Je possède aussi cette capacité : « Un soir, L. m’a dit qu’elle savait reconnaître au premier coup d’œil les gens qui avaient été victimes de violence. Pas seulement de la violence physique. Des gens dont la personnalité, la personne avait été mise en danger par quelqu’un d’autre. Elle savait déceler chez eux une forme d’empêchement, de déséquilibre, au sens propre du terme. Une hésitation, une incertitude, une faille, que personne d’autre ne semblait remarquer ». Et chez tous ceux qui ont connu ça de près ou de loin, il restera toujours une ambivalence, une frontière fragile qui pourrait vous faire basculer à votre tour du côté du bourreau ; ambivalence qu’évoque très bien Delphine De Vigan. On sait, on a appris :
« Quiconque a connu l’emprise mentale, cette prison invisible dont les règles sont incompréhensibles, quiconque a connu ce sentiment de ne plus pouvoir penser par soi-même, cet ultrason que l’on est seul à entendre et qui interfère dans toute réflexion, toute sensation, tout affect, quiconque a eu peur de devenir fou ou de l’être déjà, peut sans doute comprendre mon silence face à l’homme qui m’aimait. C’était trop tard.»
Voilà ce que L. avait réactivé : la personne insécurisée en moi capable de tout détruire.
« Mais en réalité, elle absorbait mon énergie. Elle captait mon pouls, ma tension, et ce goût pour la fantaisie qui pourtant ne m’avait jamais fait défaut. (…) Et bientôt il ne resterait de moi qu’une peau morte, desséchée, une enveloppe vide.»
Charmante au début, L. ne va pas tisser sa toile, mais au contraire, telle une méduse, dixit, brûler une part d’âme de Delphine. Pour un écrivain, quoi de plus violent qu’un tel jugement de valeur : « L. m’avait dit un jour que je n’avais écrit que deux livres. Le premier et le dernier. Les quatre autres n’étaient, selon elle, qu’un regrettable égarement » !! Elle pousse Delphine contre un mur, son échafaudage, sa volonté jusqu’à l’arnaque suprême. Si je m’attendais à une fin sadique, le coup de maître de L. à la fin m’a laissée estomaquée : coincée, Delphine pourrait succomber à la tentation. Comment L. parvient-elle à ses fins ? C’est simple, il s’agit du plus vieux truc du monde : « Et peut-être avais-je besoin de cela : que quelqu’un s’intéresse à moi de manière exclusive. N’abritons-nous pas tous ce désir fou ? Un désir venu de l’enfance auquel nous aurons dû, parfois trop vite, renoncer. Un désir dont nous savons, à l’âge adulte, qu’il est égocentrique, excessif et dangereux ».
Restera la littérature. L. a des opinions très arrêtées sur le sujet, elle bourre le crâne de Delphine de déclarations définitives sur ce que doit être la littérature alors que pour moi, cela reste une perpétuelle interrogation : « La fiction, c’est terminé pour vous (les écrivains). Les séries offrent au romanesque un territoire autrement plus fécond et un public infiniment plus large. (…) Laissez aux scénaristes ce qu’ils savent mieux faire que vous. Les écrivains doivent revenir à ce qui les distingue, retrouver le nerf de la guerre. (…) Rendre compte du réel, dire la vérité (…) Il (l’écrivain) doit se retourner sans cesse sur le terrain heurté qu’il a dû emprunter pour survivre, il doit revenir sans relâche sur le lieu de l’accident qui a fait de lui cet être obsessionnel et inconsolable ». Une quête du vrai au sein d’un livre qui entretient une ambiguïté manifeste face à ce dont il parle. L’après « Rien ne s’oppose à la nuit » a dû être compliqué pour la réelle Delphine de Vigan, ça je suis convaincue que c’est vrai. Les réactions de l’entourage peuvent être castratrices : « Ta famille a engendré l’écrivain que tu es. Ils ont crée le monstre, pardonne-moi, et le monstre a trouvé le moyen de faire entendre son cri. De quoi crois-tu que sont faits les écrivains ? Vous êtes le produit de la honte, de la douleur, du secret, de l’effondrement. Vous venez des territoires obscurs, innommés, ou bien vous les avez traversés. Des survivants, voilà ce que vous êtes, chacun à votre manière et tous autant que vous êtes. Et nous finissons toujours par être considérés pour ce que nous sommes, des bombes humaines, dont le pouvoir est terrifiant, car nul ne sait quel usage nous en ferons ». (une pensée pour Christine Angot).
Cherchons-nous toujours la part du réel dans les livres ? Cherche-t-on la part du réel dans CE livre ? Pour ma part non. Ce qui compte avant tout, c’est au coin d’une page de percuter de plein fouet son histoire, ses émotions, sa quête. Peu importent les artifices ou les faits, les illusions ou les preuves, c’est sa vie que l’on recherche sous prétexte d’évasion. Mais je reconnais une chose, une certitude qu’un dialogue d’adolescent croisé au sein « D’après une histoire vraie » établit :
« – T’as vu le nombre de films qui sortent qui sont tirés d’histoires vraies ? C’est à se demander si les mecs, ils sont pas en manque d’inspi !
Le premier a réfléchi quelques instants avant de répondre.
– Ben non… C’est surtout parce que le réel a les couilles d’aller beaucoup plus loin ».
Et, cela, c’est vrai.
- Le Bercail de Marie Causse : d'autres vies que la sienne par Thomas Messias
- Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier : tenir le chien en laisse par Anthony
- D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant par Catnatt
- Histoire de l'amour et de la haine de Charles Dantzig : rester dans sa tour par Lucile Bellan
- Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe : de quoi l’écriture se nourrit-elle ? par Alexis Joan-Grangé
- Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side par Isabelle Chelley
- Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel par Benjamin Fogel
- La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap par Catnatt
- Eva de Simon Liberati : prolonger l'obsession par Lucile Bellan
- Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène par Thomas Messias
- Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monnin (avec Alex Beaupain) : fouiller dans les photos par Lucile Bellan
- Un amour impossible de Christine Angot : nous nous sommes tant aimés ! par Arbobo
- Neverhome de Laird Hunt : l'homme qui aimait les femmes par Esther Buitekant