Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel
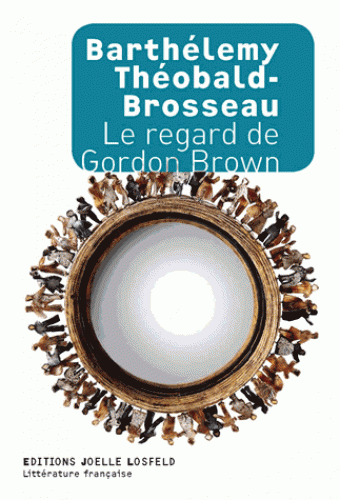
On les connaît ces jeunes auteurs pour qui écrire un premier roman est avant tout une question d’ego. Habités par la conviction que leur personnalité et leurs idées sur le monde justifient à elles seules la nécessité de coucher sur le papier 300 000 caractères, ils mettent en scène leur enfance, leur vie et leur mépris pour le monde. On dit souvent que la première œuvre d’un artiste est la plus importante parce qu’elle porte en elle tout son univers. Mais dans le cas de la fiction française, la focalisation de l’auteur sur lui-même laisse surtout penser que de toute façon il n’y aura pas la matière suffisante pour une seconde étape. Le regard de Gordon Brown, premier roman de Barthélémy Théobald-Brosseau publié aux indispensables éditions Joëlle Losfeld, a cela de rafraîchissant qu’il évite habilement l’écueil du nombrilisme.
Si le récit débute en suivant André Milcar, un jeune homme londonien qui évoque volontairement l’auteur – Barthélémy Théobald-Brosseau est un français de 26 ans qui vit à Londres –, il s’éloigne rapidement de son sujet lorsque le personnage principal se prend de passion pour une tapisserie qu’il étend dans son petit studio et devant laquelle il passe bientôt ses journées, les yeux rivés sur la matière, persuadé de voir celle-ci se mouvoir et receler mille histoires. La tapisserie, objet d’obsession, devient alors une allégorie de la télévision et du web (la toile), ces espaces physiquement délimités qui contiennent en eux le monde et que l’on peut fixer au point de finir par oublier sa vie, ou justement en réussissant grâce à eux à fuir celle-ci.
Le regard de Gordon Brown devient alors une œuvre à possibilités multiples dans laquelle on se perd soit avec plaisir soit avec ennui, selon ses besoins de repères et de rationalité. On cherche des explications. On essaye de déterminer le degré de folie d’André Milcar. On émet des hypothèses sur les personnages qui prennent vie sur la tapisserie. On cherche à comprendre qui est Kirran Bruce le Cornique, avant de réaliser qu’il n’est qu’un des nombreux tremplins qui nous permettront d’arriver à John Templeton, à la fois héros du monde que s’invente André et donc du roman dans son ensemble. On identifie des signes. On s’imagine que comme dans le Cendrillon d’Eric Reinhardt, tous les personnages ne sont peut-être que des variations de leur créateur : les émotions du héros deviennent celles des personnages – John sent lui aussi une barre poindre dans sa poitrine et des vagues monter dans sa gorge – ; avant que ces derniers ne commencent à lui échapper, à parler des langues qu’il ne comprend pas, à avoir des conversations sur des sujets où il serait bien en peine d’apporter sa contribution ; avant qu’ils ne bifurquent et vivent les vies qu’il aurait pu vivre, mais qu’il ne vivra pas. Sauf que rien n’est simple ici. Les personnages du personnage commencent à inventer eux-mêmes des personnages, et Le regard de Gordon Brown se met à interroger la fiction en lui demandant jusqu’où elle peut aller.
Il y a une très belle phrase dans le livre que Barthélémy Théobald-Brosseau emploie pour décrire l’amour, mais qui selon moi illustre avant tout sa vision de la littérature : « Si l’on veut jouer ce jeu, il faut des qualités particulières : il faut savoir douter, car c’est du doute seulement que naissent la confusion, l’hésitation, le transitoire, tous ces espaces qui rendent impossibles les conclusions. Si l’on veut jouer, il faut savoir regarder le monde de travers ».
Forcément, au travers de cette approche qui s’efforce d’observer les événements sous un angle différent, Barthélémy Théobald-Brosseau rappelle les élucubrations d’Eric Chevillard, sans malheureusement jamais les égaler. La bizarrerie tombe parfois un peu à plat quand elle se limite par exemple à simplement exagérer un paramètre (confère « Quand sa tasse fut vide, il s’étira, fit quelques flexions et partit courir cent vingt kilomètres ») et certains passages sont soit trop absurdes soit pas assez (comme la digression sur les pigeons et les merles), mais la majorité du temps les petits mots et les petites modifications du réel font mouche. Il jongle avec le temps et les époques. Il inclut au fur et à mesure toujours un peu plus de modernité dans son texte, donnant parfois l’impression que les personnes se déplacent en calèche le jour, mais regardent Youporn la nuit.
Surtout, Barthélémy Théobald-Brosseau réussit à démontrer comment nous cherchons, puis trouvons un sens à notre vie en observant celle des autres, en nous lassant de la vie des autres, et en redonnant potentiellement la priorité à notre vie sur celle des autres. Son texte n’est pas si critique que cela sur les mondes imaginaires que peuvent représenter Internet et la télé. Compte tenu de la conclusion du texte, on peut même considérer le virtuel comme un passage obligé qui permet de se trouver. « Le virtuel, c’est le chant du faux et du possible » fait-il dire à Fossoriero y Barreto, un poète colombien qui n’est rien d’autre qu’un nouveau personnage inventé. Le regard de Gordon Brown devient un anti Portrait de Dorian Gray : c’est la tapisserie qui évolue et André qui reste le même et qui n’avance plus dans sa vie. Le virtuel absorbe le temps et le fige. Il génère de la bizarrerie pour nous permettre de garder pied dans la réalité.
Le regard de Gordon Brown, c’est l’histoire d’un jeune adulte prédestiné au nombrilisme et qui décide de devenir fou pour ne plus s’intéresser qu’aux autres. En cela, on peut dire qu’il occupe une saine position au sein de cette nouvelle rentrée littéraire.
- Le Bercail de Marie Causse : d'autres vies que la sienne par Thomas Messias
- Deux messieurs sur la plage de Michael Köhlmeier : tenir le chien en laisse par Anthony
- D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan : écrire le vivant par Catnatt
- Histoire de l'amour et de la haine de Charles Dantzig : rester dans sa tour par Lucile Bellan
- Charøgnards de Stéphane Vanderhaeghe : de quoi l’écriture se nourrit-elle ? par Alexis Joan-Grangé
- Downtown Diaries de Jim Carroll : un tour dans le wild side par Isabelle Chelley
- Le regard de Gordon Brown de Barthélémy Théobald-Brosseau : se trouver dans le virtuel par Benjamin Fogel
- La terre qui penche de Carole Martinez : perdre le cap par Catnatt
- Eva de Simon Liberati : prolonger l'obsession par Lucile Bellan
- Sfumato de Xavier Durringer : un problème de mise en scène par Thomas Messias
- Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monnin (avec Alex Beaupain) : fouiller dans les photos par Lucile Bellan
- Un amour impossible de Christine Angot : nous nous sommes tant aimés ! par Arbobo
- Neverhome de Laird Hunt : l'homme qui aimait les femmes par Esther Buitekant