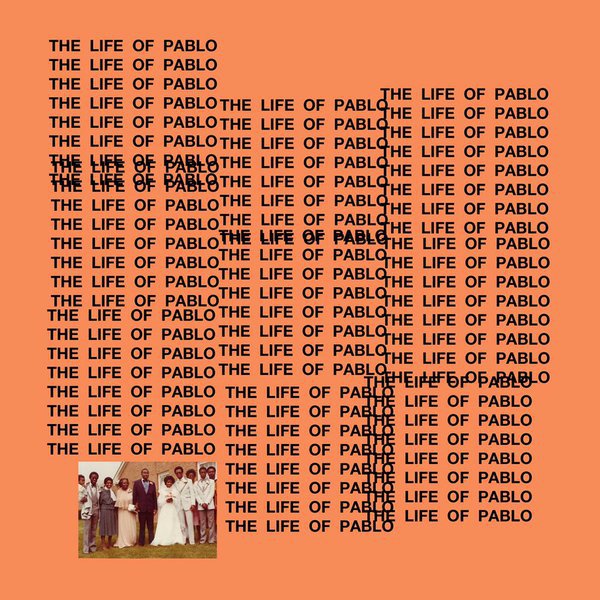Dans Yeezus, Kanye West établissait un dialogue fertile et furieux avec le sample d’une Nina Simone reprenant « Strange Fruit », hymne engagé de Billie Holiday. Dans The Life of Pablo, et plus particulièrement avec l’illustre « Famous », c’est au tour de Rihanna de marcher sur les cordes vocales de Sa Seigneurie Simone, dans un registre sentimental cette fois, celui de « Do What You Gotta Do ». Rihanna, phénomène pop issu de l’île de la Barbade comme l’était l’esclave Tituba des Sorcières de Salem d’Arthur Miller, se retrouve ainsi funambule pour les beaux yeux de West, bon génie capricieux qui voit s’agiter devant lui celle à qui il susurre qu’elle ne mourra jamais, pour la simple raison qu’il n’a pas encore choisi de s’en détourner. C’est toujours pareil avec Yeezy-West. Quand il parle des “putains de loups” qui nous entourent, on ne sait pas vraiment s’il dénonce des siècles d’oppression triomphante du Caucasien drapé d’Antiquité, ou bien s’il pourrit le lascar qui lui a chapardé la dernière paire de sneakers griffée par ses soins.
Qui est Pablo ? Un salaud magnifique, un esprit majeur, qu’importe. Dans cet album qui se veut davantage courant artistique qu’énième production culturelle et qui veut vivre à la hauteur de ses ambitions, tout est permis puisque les lois n’ont plus cours. Ainsi, une machine à tubes comme Sia est appelée comme simple chœur, mais peut s’estimer chanceuse de savoir de quel titre – « Wolves » – là où Bon Iver ou Travis Scott se demandent encore à quels endroits de Yeezus les éclats de leurs voix auront été projetés par une véritable déflagration sonique canalisée avec toute la patience du démiurge Rick Rubin. Comme si West, jadis contributeur salué de Ludacris ou Janet Jackson, faisait payer aux nouvelles vedettes, comme à autant de sujets, ce qu’il considère aujourd’hui comme un bizutage illégitime. Et pour que les choses soient claires, l’allégeance à lui-même passe chez le rappeur de Chicago par des clins d’œil à des œuvres de jeunesse (“Wake up Mr West!”, ouï dans Late Registration) ou par des titres entiers sertis d’un second degré gonflé à la fausse modestie (“I even had the pink polo I thought I was Kanye”).
Quand il fait de son flow un prêche (“Pray for Paris / Pray for the parents / This is a God dream”) ou quand il se place dans le tutoiement des dieux, c’est business as usual. Kanye West crée son propre langage phatique, un bruit de fond se piquant de musique sacrée d’un genre nouveau. C’est une ambiance comme une autre, de l’encens dans le studio, une séance d’assouplissements mystiques sans lesquels il ne se sent pas capable de créer la matière sonore qui redéfinira l’ensemble des jours suivants. Et l’ambivalence étant sa came, West convoque soudain Young Thug, prodige, pour mettre en valeur une de ses pièces d’orfèvrerie – « Highlights » – , au long de laquelle son âme/arme pèse “21 Grammys”. Tout ce qu’il touche, artwork, vêtements, mobilier, paraît devoir se changer en or et c’est la moindre des choses au vu de l’énergie qu’il emploie à laisser une trace. Sa sensibilité, sa curiosité, tout ce qui peut trahir la recette de son succès, West semble prêt à chaque instant à le remettre en jeu au profit d’une nouvelle trouvaille qui le mettra définitivement à l’abri du moindre impétrant, talentueux ou non.
Un outil qui vous propulserait au hasard dans un endroit de The Life of Pablo pourrait faire de vous, selon : un spectateur de film non tourné, le fidèle d’un culte de la personnalité, un archéologue récalcitrant, le petit être de la loge noire, le dernier client du dernier club sur terre ou bien vous-même, mais dans une version encore inédite. Kanye West n’est pas sans évoquer la figure ambiguë de Jason Compson, personnage du Bruit et la Fureur de William Faulkner, qui ne choisit jamais entre la faveur du destin et le désir d’en découdre.