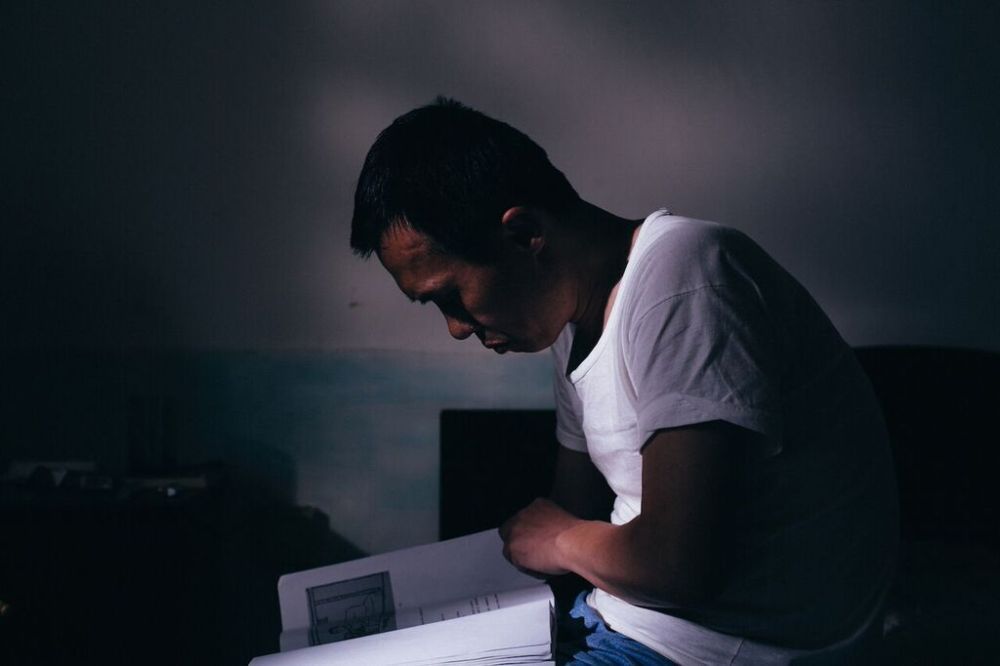Les premières minutes ressemblent à s’y méprendre à du Weerasethakul, cinéaste thaïlandais palmé à Cannes pour Oncle Boonmee. Des gens parlent dans une pharmacie, le ton est posé, la caméra délicatement fluide. Le film alterne les plans fixes et les mouvements d’appareils délicats, la profondeur de champ et le flou artistique du plus bel effet. On ne sait pas trop où on est mais c’est agréable. On comprend sans mal qu’il est question de deux frères, dont un, Chen, sort de prison et que ces derniers se disputent la garde de Weiwei, le fils de Chen. Scène à un stand de tir de fête foraine, discussion sur une terrasse, manipulation d’un engin de chantier, pas un plan ne parait en trop. A vrai dire, seule la langue trahit qu’il ne s’agit pas d’un film de Weerasethakul : pas de thaïlandais ici, avec ses mots liés tout en douceur. L’oreille néophyte de l’Occidental reconnaît plutôt du cantonnais, ou un dialecte proche. Et pour cause, Kaili Blues est un film chinois, de Bi Gan ; son action prend part dans la province de Guizhou.
Cette parenté commence à faire tiquer autant qu’elle est agréable quand Bi Gan use d’une autre figure qu’on retrouve souvent chez le thaïlandais. Au bout de vingt minutes de film, le titre du film s’affiche, puis Chen, parti à la recherche de son fils, chevauche son scooter, parcourt une route de montagne pendant que résonne une musique pop. On avait peu ou prou la même scène à la moitié de Blissfully Yours : un trajet en voiture vers la jungle, une musique entraînante et le générique d’un film déjà bien entamé qui défile. Chez Weerasethakul, le procédé accentue la césure récurrente de ses films, entre urbanisme et grands espaces, entre plongée sociologique et rêverie fiévreuse. On ne le sait pas encore, mais Kaili Blues entame aussi sa mue à partir de ce point.
Le plan-séquence est un art martial
Peu à peu, la caméra se libère. Les plans fixes se font rares et de longs plans-séquences font leur apparition. Sauf qu’au contraire d’un Iñárritu avec Birdman, Bi Gan ne cherche pas la perfection du long plan souple. Au contraire, ses plans-séquences sont heurtés, accidentés. On devine sans mal le cameraman enfourcher un scooter pour suivre un véhicule en mouvement, on le sent s’embourber dans le sol meuble et humide des bords du fleuve, on perçoit sans mal l’imperfection de la mise au point et les tremblements naturels du corps. C’est que, en dépit de l’utilisation d’une petite caméra, le défi technique est de taille. Un plan commence comme une simple exposition avec plusieurs scooters garés. Un homme part avec une jolie fille, un second démarre sa bécane ; la caméra le suit. Le passager s’arrête, descend et va dans un village. La caméra lui emboîte le pas, s’adaptant à aux ruptures de rythme. L’homme repart à l’arrière d’une camionnette, se ré-arrête, prend à nouveau un scooter, parcourt le village en contrebas. La caméra ruse et prend des raccourcis, elle s’écarte pour laisser le chauffeur le frôler. On a affaire à un vrai challenge sportif, celui de tenir la distance tout en rendant lisible l’action.
Mais là où Kaili Blues justifie son utilisation du plan-séquence, c’est que finalement, la finalité scénaristique est moindre. Il cherche un enivrement plus volupté. A tel point que passé un stade du film, on ne suit qu’à moitié ce qui se dit, on contemple juste le monde, on respire ses odeurs, on écoute les bruits des pas sur un pont, on sourit de voir passer la barque en contrebas sur le fleuve alors qu’on était dessus cinq minutes auparavant. L’errance n’a plus de but. De temps à autres, on espère croiser le jeune Weiwei. On accompagne les personnages à la 3e personne comme on le ferait dans un GTA ou un Shenmue, deux jeux-vidéo précurseurs dans la notion de monde ouvert. Car si la nature même du cinéma est de diriger notre regard, Kaili Blues invente quasiment la sensation de monde ouvert dans le septième art. Tout ses personnages vivent, bougent hors-champ. On suit un personnage A puis B, mais au simple hasard des pérégrinations.
Le grand plaisir de l’invention des mondes ouverts dans le jeu vidéo, c’est de pouvoir “perdre” son temps à ne rien faire. Il est possible de contempler un coucher de soleil, de jouer au go, de regarder la télé, de conduire sans but dans les rues en écoutant la radio (un passage de Kaili Blues offre la même sensation) ou de chasser à la massue dans le récent Far Cry Primal. A vrai dire, il est possible de passer une vie dans ces jeux sans jamais avancer d’un pouce dans l’histoire. Par moment, la même sensation se dégage de Kaili Blues. Non pas que ça soit unique dans l’histoire du cinéma (on pourrait totalement passer une vie avec les gamins d’Il était une fois en Amérique ou dans le village défendu par les Sept Samouraïs). Ce qui est nouveau ici, c’est la sensation que la mise en scène nous pousse à nous égarer. Peut-être que si le film avait été tourné le lendemain, le voyage aurait été complètement différent. Kaili Blues va même agrémenter son voyage de pensées philosophiques. En une heure, on travers un fleuve, révise la géographie régionale, achète un moulin à vent pour enfant, va chez le coiffeur, écoute un concert de rue. Ça ne sert à rien ? C’est ce qui est génial, et passionnant.
Pourtant, pour faire dans la métaphore filée, le film suit des rails – celle de trains notamment – et ne profite pas à fond de son processus de liberté, justement peut-être pour éviter que cette mise en scène ne devienne un dispositif sclérosant. La partie du film la plus libre correspond à l’errance plus ou moins fantasmée de Chen. Kaili Blues multiplie les motifs d’horloges aux trotteuses qui tournent, indiquant le temps qui coule, impassible dans sa linéarité. Parce qu’à la fin, le voyage s’achève. On se prend à rêver que Weerasethakul, plus puissant conteur de fantasmes que Bi Gan, libère ainsi sa caméra. La fusion des deux approches pourrait donner un chef d’œuvre ultime de voyage ouvert. Quant à Bi Gan, vivement qu’il ait accès à la réalité augmentée.