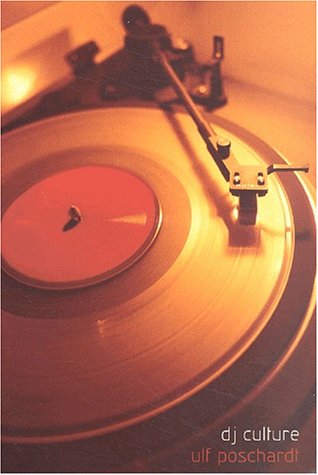The Get Down (1) : trouver le parrain du hip-hop
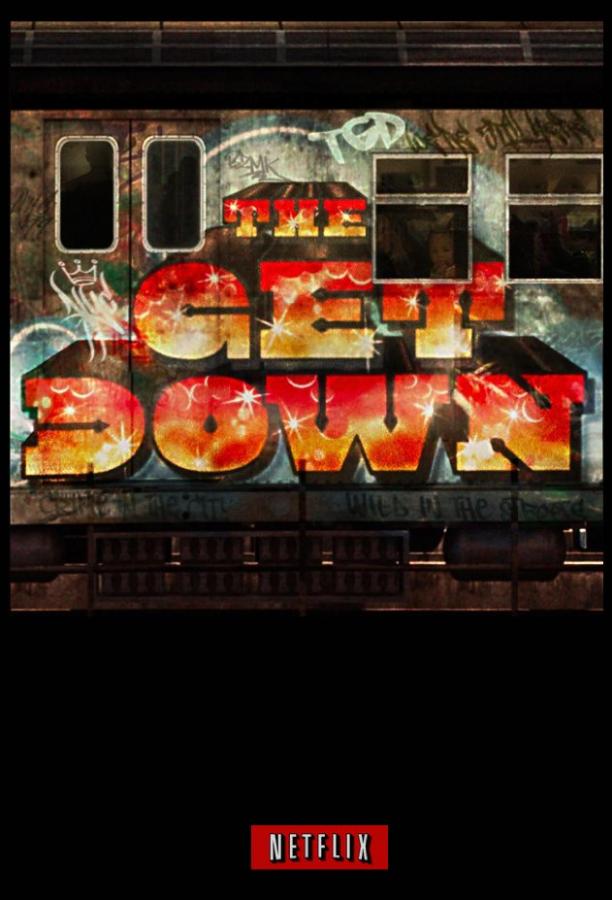
Le thème d’ouverture de La guerre des étoiles résonne dans un terrain vague. Un DJ scratche par dessus pour marquer son empreinte, et quatre adolescents enchaînent les rimes au micro sur un beat féroce avec une synchronisation qui met la foule en délire.
Voilà ce qu’on s’imagine voir en se lançant dans la nouvelle série de Netflix, The Get Down, dont la première demi-saison (6 épisodes) a été dévoilée récemment. Préparez-vous à revivre les premiers temps du rap, nous laisse-t-on entendre, revivez-les de l’intérieur, au cœur du Bronx, comme si vous y étiez. À moins que… cette manière de présenter la série, qui sature le discours consacré à sa sortie, ne soit qu’une partie de l’histoire. Pas forcément la plus grande partie, d’ailleurs. La scène en question a bien lieu, c’est le point d’orgue de la mi-saison (la 2e moitié sera diffusée en 2017). Mais avant d’en arriver là, beaucoup de détours et circonvolutions font douter qu’il s’agisse d’une « série sur le hip hop ». Cela n’en reste pas moins une excellente raison pour plonger dans l’histoire du hip hop et dans celle de New York.
L’histoire encore récente de la culture hip-hop
La sortie de The Get Down a provoqué un énorme écho sur les réseaux et dans les médias. Indéniablement, il y avait une attente. Non seulement la place du rap dans la culture des moins de 40 ans est gigantesque –beaucoup des plus grandes stars récentes en sont issues– mais il n’existe pas énormément d’œuvres liées à l’histoire du hip hop. Quelques livres (dont le roman de Laurent Rigoulet qui vient de paraître), peu de films, et en tout cas en France plus aucune émission dédiée à la télévision. Des noms prestigieux à la manière dont la série a été promue, tout est fait pour que le public s’attende à une série « sur le hip hop », voire carrément sur ses tout premiers pas. La voix « adulte » du narrateur n’est-elle pas celle de Nas ? Lui qui est d’ailleurs l’un des principaux producteur de The Get Down. Alors prenons d’abord cet angle au sérieux. À quelles sources The Get Down a-t-elle pu s’abreuver pour nourrir son côté hip hop ?

L’histoire débute en 1977. Les personnages principaux masculins (donc à peu près tous les personnages principaux) sont des adolescents du Bronx qui aspirent à devenir un crew de rappeurs, dans un monde où le hip hop est en train de se structurer comme mouvement. Au centre du groupe, Ezekiel, un orphelin doué pour les mots. Mais la bande compte aussi un grapheur, Rumi, inspiré des légendes de l’époque, et un DJ élève de Grandmaster Flash, l’un des pionniers du hip hop et du scratch. Les célébrités qui apportent leur crédit à la série viennent toutes du monde de la musique – deux chanteurs (Kurtis Blow, Nas) et un DJ (Flash)– pas du graph ou de la danse qui sont sont aussi des composantes à part entière de la culture hip hop. Pourquoi tant de fascination à l’égard des musiciens ?
Le hip hop est bien né à la fin des années 70, mais comme la plupart des genres nouveaux, il utilise des éléments déjà existants. On peut rattacher le rap, comme technique de chant, au « spoken word » utilisé de longue date, notamment par Gil Scott-Heron. Le MC qui anime la soirée et improvise vocalement sur un soundsystem, ça existait aussi avant, à la Jamaïque, sur du rock-steady et du dub (cf. la belle expo « Say-watt, le culte du soundsystem » à la Gaité lyrique, 2013, qui comportait aussi des photos des débuts du rap NY par Sophie Bramly). La break dance est franchement délaissée dans la série, mais le graph a une petite place, derrière le scratching et le rap.
En tant que reconstitution, c’est néanmoins réussi. Survolé, mais réussi. Et nous serons nombreux à pouvoir en juger, car même si nous n’avons jamais assisté à une block party dans le Bronx ou à Harlem en 1977, cette histoire-là a été contée à plusieurs reprises. Musicalement, tout est traité en long et en large dans Can’t stop, won’t stop de Jeff Chang, préfacé par DJ Kool Herc et traduit en 2006. Deux autres bouquins importants replacent le hip hop dans une histoire plus longue et en lien avec les musiques électroniques ou la house. Le premier, DJ Culture de l’allemand Ulf Poschardt, est d’une richesse incroyable. Le second est une BD française, Le chant de la machine, dont la réédition en petit format ne rend pas justice à la puissance visuelle. Mais si géniaux qu’ils soient, ces deux ouvrages ne sont pas des encyclopédies et ne prétendent pas à l’exhaustivité.
Le Hip Hop Family Tree, influence revendiquée à tort?
Voilà qui nous amène au Hip Hop Family Tree, présenté par la production comme la source d’inspiration de The Get Down, sans que cela saute aux yeux du spectateur averti. Hip Hop Family Tree est un beau comic d’Ed Piskor, traduit en français en septembre 2016, qui retrace toute l’histoire du hip hop depuis 1975. D’abord sur le site Boingboing, puis en version papier, Piskor y a consigné tous les détails, toutes les soirées, tous les apports des uns et des autres, rapportant parfois des souvenirs inédits. Bref, l’histoire complète du hip hop. Rien de mieux, par exemple, pour enfin savoir comment des inconnus qui n’avaient jamais rappé, The Sugarhill Gang, se sont retrouvés en tête des charts avec “Rapper’s delight”.

Ed Piskor – The hip hop family tree (passage sur le film Beat street)
Ed Piskor met l’accent à 95% sur la musique, et il le fait avec un degré de détail impressionnant. Du coup, il n’y a guère de place pour la narration. The Get Down fait le choix inverse : beaucoup de narration et pas énormément de faits. Dès lors la référence au Hip Hop Family Tree relève surtout du marketing. Avec Nas, mais surtout avec deux figures majeures de l’époque, Grandmaster Flash et son acolyte Kurtis Blow, comme producteurs du show, il y avait déjà en soi bien plus de connaissances disponibles pour reconstituer les débuts du hip-hop que la série n’en utilise réellement. Flash et Blow apparaissent d’ailleurs en tant que personnages dans la série (surtout Flash à vrai dire, car la série se déroule dans le Bronx). Ce n’est pas la première fois que ces deux-là deviennent des personnages de fictions. Kurtis Blow, qui officiait à Manhattan (mais a fait des duo avec Flash à la grande époque), a eu l’occasion de jouer son propre rôle dans un (mauvais) film de 1985, Krush Groove, où défilent tout ce que la ville comptait de rappeurs connus. Dit autrement : Hip Hop Family Tree a peut-être fourni l’idée de départ de The Get Down, mais pas la matière première.
L’enjeu de l’hégémonie
D’ailleurs Flash et Kurtis ne sont que des figures parmi d’autres dans le comic, qui s’intéresse autant à la Zulu Nation, à Spoonie Gee et à bien d’autres protagonistes moins connus. À travers The Get Down, ce qui se joue ici, c’est la volonté de Flash d’imposer son hégémonie au sein de la génération des fondateurs. Le vrai héros du rap dont l’ombre ne cesse de planer sur le show, c’est Flash, pas Bambaataa ou Kool Herc, deux autres figures majeures du mouvement, qui eux sont à peine mentionnés. S’impliquer dans la production, c’est le moyen d’orienter l’histoire à son propre avantage. On est franchement très loin du Hip Hop Family Tree qui recense exhaustivement les actions de tous ceux qui ont compté, tels que Busy Bee, Spoonie Gee ou Sha-rock.
Flash joue sur du velours, car Herc est assez discret dans les médias, tandis que Bambaataa reste généralement à l’écart de tout ce qui touche au maintream. Pour connaître le point de vue de Bambaataa et découvrir un autre point de vue sur l’histoire du rap dans le Bronx de 1977, il faut se tourner vers d’autres sources. Comme l’excellent documentaire télévisé NY77 : the coolest year in hell. Cette question de l’hégémonie continue de se jouer dans les générations suivantes, le film récent sur les NWA en est un exemple, ou la série à venir The breaks, produite comme le film dont elle est tirée, par DJ Premier. Produire, c’est apposer sa marque et imposer sa version de l’histoire.
Filmer les graffiti, filmer le hip hop
L’autre composante du hip hop, dans The Get Down, c’est le graffiti. Si la série est bien filmée et se laisse regarder, elle est surtout très bien jouée. La comparaison avec Wild style (1982), le film culte sur le hip hop, s’impose. Tout y est joué avec les pieds, mais chaque plan sonne vrai: une majorité du casting, dont les grapheurs Quinones et Lady Pink, n’avaient aucune expérience de comédie. Or cette petite série B sur une bande de grapheurs du Bronx propose des motifs qu’on retrouve, version technicolor, dans The Get Down. Dans Writers, un documentaire français vraiment intéressant, on réalise que le graph était dans les 80s la partie la plus internationalisée de la culture hip hop – plus que le rap dont le développement en France a une histoire plus compliquée (retracée dans l’excellent livre de Karim Hammou, Une histoire du rap en France). Le graph, dans The Get Down, est présent sans l’être. Tout comme le break dance d’ailleurs (qui domine dans Breakin‘, 1984). On est loin de The Style Wars, génialissime documentaire de 1983 sur le graph, ou encore de Beat Street, film de 1984.
On gagne à faire la comparaison avec ce dernier, parce qu’elle révèle en creux ce que The Get Down n’est pas. Dans Beat Street, les morceaux de rap durent plusieurs minutes, et c’est le seul style musical qu’on entend. Les parties sont filmées maladroitement mais en privilégiant au moins autant la danse et les MCs que l’intrigue. Et pour ce qui est de la street cred’, le film n’est pas en reste puisqu’il réunit Bambaataa, Kool Herc, les Treacherous Three qui ont inspiré le crew fictif de The Get Down, Melle Mel et quelques autres. Avec Wild style, on est clairement face à l’un des films indispensables sur le hip hop . D’ailleurs, Ed Piskor leur consacre de longs épisodes. Il est amusant de voir à quel point Beat Street suinte le hip-hop de tout son entrejambe, alors que le Hip Hop Family Tree rapporte que Hollywood en a justement gommé les aspérités. Si The Get Down se revendique du Hip Hop Family Tree, il devrait être franchement hardcore, or au contraire il s’avère mille fois plus édulcoré que Beat Street.
La danse, hyper présente dans Beat Street, Breakin‘ et The Style Wars, passe ici à l’as. Et pour cause : il y a des tonnes d’éléments dans The Get Down qui sont étrangers au hip hop. Impossible par conséquent de traiter ce dernier de manière fouillée. Ce n’est pas forcément un défaut en soi, mais après avoir comparé The Get Down à d’autres objets filmés (et encore, sans même s’aventurer dans les années 90s, celles de Boyz n the hood ou de The Breaks), on ressent une forme de malentendu.
Certes la série fourmille de détails bien vus, comme les cahiers de graphs que les « writers » s’échangent à la station de la 149th, ou l’atmosphère débridée du Loft. Mais en dépit des stars qui se sont penchées sur son berceau, le hip hop n’en reste qu’une toile de fond plus que la matière première. Le plus représentatif de ce constat est d’ailleurs, ironiquement, la bande son de The Get Down. (à suivre)
- The Get Down (1) : trouver le parrain du hip-hop par Arbobo
- The Get Down (2): jeu de pistes musical par Arbobo
- The Get Down (3): Les séries musicales, un genre naufragé par Arbobo
- The Get Down (4): New York, roman d'une ville par Arbobo
- The Get Down (5): Un mélange des genres mal maitrisé par Arbobo
- The Get Down (6): une série moralement correcte par Arbobo