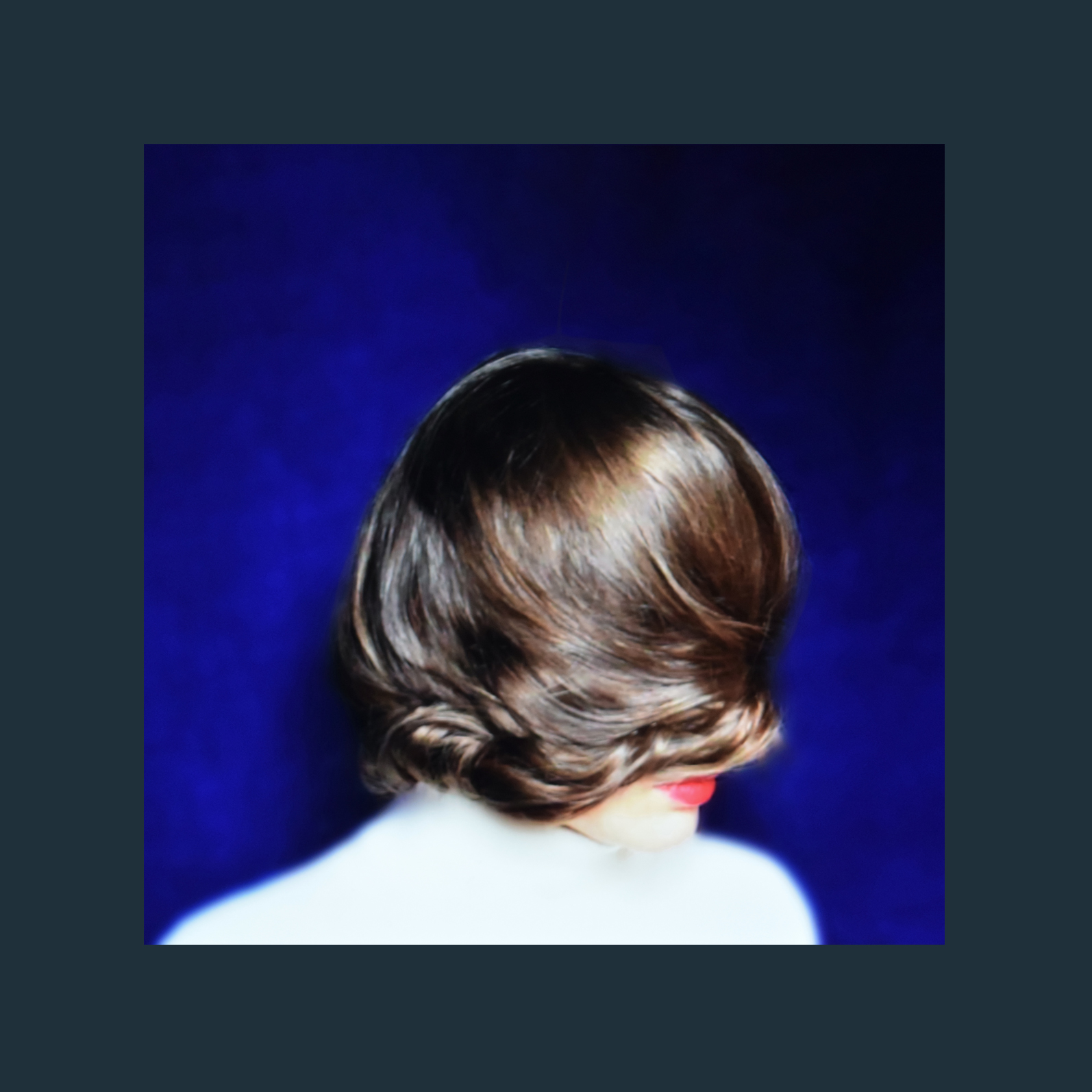Les vents sur l’eau. Si Pauline Drand était un ou des éléments, elle ne serait sans doute pas le feu. Elle est trop calme et posée. Ni la glace, car elle est d’une gentillesse attentionnée qui touche rapidement son interlocuteur, mais aussi parce qu’elle est parcourue d’émotions profondes. Sous l’eau, force et douceur, des courants de fond s’agitent à l’insu de qui est en surface, et on ne perçoit que les ridules de la brise qui nous emmène d’une rive à l’autre.
On a déjà entendu Pauline Drand. Ses grands yeux couvrent l’assistance avec bienveillance. Une familiarité s’installe, un lien se noue dès les premières mesures. En concert, la jeune musicienne devient vite une grande soeur qui nous adopte et nous prend par la main pour un long voyage. Sur disque, grâce à une production équilibrée, pleine de cordes mais pas chargée, et un mixage au cordeau, on parierait volontiers que l’effet est aussi fort sur celles et ceux qui la découvriront ainsi.
Ce qu’on aime d’abord, instantanément, c’est cette voix grave sans être caverneuse, ce souffle profond qui vient de loin à l’intérieur. Son chant traîne au fond du temps, comme si elle se souvenait au dernier moment que c’est à elle d’y aller. Avec une apparente nonchalance, elle qui pourtant a toujours l’oeil aux aguets et n’en perd pas une miette. Leonard Cohen avait aussi cette fausse désinvolture.

Pauline Drand par Visions particulières
Du folk, Pauline Drand illustre une dimension essentielle : la voix porte la mélodie, tandis que les instruments accompagnent. La voix c’est elle, c’est le corps, et ce sont aussi, indissociablement, les paroles. Les instruments sont d’abord là pour souligner, mettre en valeur, et pour appuyer une couleur. Rares sont les “effets”, un peu sur la voix dans « Faits bleus », une virgule de cordes dans « Betty ». Sur « Les roses », on entrevoit un éphémère reflet de Karen Dalton sur une finale en aigus, imperceptible si l’on ne sait pas qu’elle a rendu hommage à l’américaine dans son disque précédent. La nuance, toujours. La finesse.
Faits bleus donne avant tout l’impression d’un album très uni, malgré la fin de « Gangsters ». Mais plus on l’écoute et plus des nuances se révèlent, dans le style, les arrangements, la voix posée en bas des graves ou portée aux aigus. On voudrait décortiquer chaque titre. Par exemple suivre comment « Gangsters » change à mi-parcours, devient plus riche ; comment, plus sensuelle, une nouvelle musicienne se dévoile, zigzaguant entre swing et western, dans une approche très cinématographique. D’ailleurs, un disque ou un concert de Pauline Drand, c’est un peu retrouver Anna Karina dans un Godard inédit des années 60. Dont elle aurait fait la BO.
Sur Faits bleus, on entend avant tout des chansons de femme, de femmeS, au singulier, au pluriel, de “petites filles” (« Betty »), de l’autobiographie, des vies inventées, rapportées. Pauline Drand parle toujours à quelqu’un, l’interroge, telle la “petite soeur” évoquée avec les accents d’une Barbara Carlotti (« Porte d’Italie »). Alice parle à “sa pareille” de l’autre côté du miroir, sans le franchir.
Rêveuse, Pauline Drand ? N’est-elle pas “au large du monde… en marge du monde” ? Si c’est le cas, elle a des nuits ombrageuses, peuplée de “gangsters” et de “vaincus”, une “jeunesse perdue et phalanges nues”.
Pauline Drand est autant une auteure qu’une musicienne ou une chanteuse. Comme Sagan, elle a l’art de nous faire ressentir l’imperceptible. Comme les nouvelles de Tennessee Williams, elle retrouve l’art des saynètes, de poser des caractères, des déceptions, en quelques lignes. Comme Duras, enfin, elle ressuscite la manière de faire sonner différemment les mots du quotidien, de glisser “tendreté” là on l’on aurait prédit “tendresse”, et le refus des rimes. Plus Bertrand Belin qu’Etienne Daho, malgré le clin d’oeil au boulevard des Capucines.
« Aux jours de juillet », un pur bijou, clôt l’album comme on referme sur son coeur un livre de souvenirs.
Tout est si élégant lorsque Pauline Drand parait, qu’on dresse l’oreille à chaque risée qui se lève, en espérant l’y retrouver.