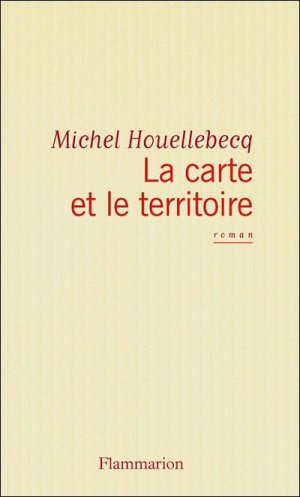On devrait toujours faire confiance aux gens pour qui l’automne est la saison préférée (ou à minima éprouver envers eux une forme de bienveillance). Aussi lorsque Michel Houellebecq (au travers de Jed Martin) dit Il n’y a qu’à l’automne où Paris soit vraiment une ville agréable, on pense instinctivement aux épiphanies automnales de Eric Reindhardt dans « Cendrillon » avec qui il partage le besoin de mettre les personnages en perspective des tendances sociales et des aléas de nos systèmes économiques. Trouver que c’est en automne que les villes sont les plus belles n’a rien d’anecdotique, c’est se placer dans une posture contemplative qui ne s’apitoie pas sur elle-même et qui se laisse enrober par ces teintes particulières du soleil si propices d’abord au vague à l’âme puis à la résignation.
« La carte et le territoire » est justement un livre sur la résignation. Douze années durant, Houellebecq a vécu avec la conviction (peut-être un brin utopiste) que le clonage procurerait à l’homme une forme d’immortalité et que les effets du temps qui se dessinaient peu à peu sur son corps n’étaient qu’une fatalité passagère, un cap difficile à passer en attendant que la science ne progresse et franchisse la limite – cette conviction trouvant évidemment son apogée dans « La Possibilité d’une île ». Pourtant dès l’adaptation cinématographique de ce dernier, on sentait qu’il n’y croyait plus, ou plutôt que si, qu’il y croyait encore mais qu’il savait qu’il mourrait avant que les recherches n’aient abouti. Du coup, d’un point de vue idéologique, ce cinquième roman marque une cassure ; pas étonnant que les théories sur la misère sexuelle aient laissé la place à un désintérêt poli pour la concupiscence, là aussi, il y a de la résignation et plus encore une acceptation de la finitude de la vie, une acceptation qu’on lit en filigrane comme un : quitte à tout perdre un jour autant ne rien posséder tout de suite. D’habitude les personnages houellebecquiens ont à se débattre avec les turpitudes de nos sociétés contemporaines. Là ils sont dès le départ en dehors de celles-ci. Oui, ce que certains percevaient comme des provocations a disparu, car l’heure n’est plus aux positionnements tendancieux mais bien aux constats lasses.
L’autre conséquence de cette résignation se retrouve au niveau stylistique même. Ce qui pourrait préalablement passer pour le passage à une strate supérieure en termes d’économie de moyen (suppression des toiles de fond, descriptions visuelles limitées au strict minimum…) se révèle être une forme de paresse : le style est lénifié au point de devenir fade et en oublie le sens des formules qui, a défaut d’être toujours brillantes, rythmaient d’une certaine manière les paragraphes. L’effet est particulièrement tragique dans sa troisième partie. Au moment où le personnage Michel Houellebecq décède, l’âme de « La carte et le territoire » meurt avec lui et l’on se retrouve dans un livre bancal à l’enquête banal qui joue avec un genre (le genre policier) auquel il n’a strictement rien à apporter. A moins que dans une nouvelle mise en abyme – le roman est effectivement truffé de phases à reconsidérer dans le cadre de la réalité de l’auteur comme ce C’est une grosse partie qu’on joue, tu sais. C’est très difficile de faire accepter une évolution artistique aussi radicale que la tienne. Et encore, je crois que c’est dans les arts plastiques qu’on est le plus favorisés. En littérature, en musique, c’est carrément impossible de changer de direction, on est certain de se faire lyncher. D’un autre côté si tu fais toujours la même chose on t’accusera de te répéter et d’être sur le déclin, mais si tu changes on t’accuse d’être un touche-à-tout incohérent – Houellebecq ait voulu justement souligner combien l’apport de l’artiste était nécessaire dans notre société et combien son absence vidait le quotidien de son essence.
De plus, sa tendance à recourir trop fréquemment au name-dropping, empêche « La carte et le territoire » de laisser l’impression nécessaire d’un roman durable. C’est comme si dans une dernière manifestation de son cynisme – et ce alors que l’instantanéité des choses semble l’affliger – Houellebecq cherchait à nous dire que son roman non plus ne perdurerait pas, que sorti de son contexte de 2010 il ne vaudrait plus rien. Dans cent ans, les références à Jean-Pierre Pernaut et à Frédéric Beigbeder seront vides de sens et « La carte et le territoire » se décomposera lui aussi sous l’effet de l’acide.
Néanmoins, malgré une remarque d’une rare stupidité sur Picasso qu’on ne peut imaginer n’être que ironique ou bêtement provocatrice (dans le cas contraire, on conseillera à Houellebecq de jeter un œil au hasard à Gertrude Stein ) « La carte et le territoire » s’avère souvent être un grand roman sur l’art qui évite les clichés sur l’art contemporain, qui sait souligner les questions financières et le cirque médiatique sans les galvaniser et les mettre au premier plan, et qui surtout sait reproduire avec justesse ce qu’est l’expérience artistique vécue du côté de l’artiste. Alors que le sujet est particulièrement casse-gueule, la mise en perspective au cours des décennies des œuvres de Jed Martin est pertinente et pleine de sens : les orientations ne s’y expliquent pas par de grosses ficelles ou par de vulgaires traumatismes implicites mais par une multitude de détails et de positionnements par rapport à la société. Les concepts ne sont jamais éculés et les réalisations de Jed Martin possèdent une vraie logique, une vraie crédibilité, comme si elles avaient réellement existé. On pourrait trouver que c’est la moindre des choses qu’un tel écrivain puisse inventer avec brio des vies entières et les créations qui les accompagnent, mais encore une fois inventer sur le papier des œuvres graphiques et ce sans lourdeur ou maladresse est un exercice périlleux où les plus grands conteurs peuvent se casser les dents.
Houellebecq ? C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision juste de la société. Etait-ce bien utile d’écrire sur « La carte et le territoire » après une telle déclaration ?
Note : 7,5/10